Pour la cinquième année consécutive, le festival des Hypermondes se tenait les 20 et 21 septembre à Merignac, dans la proche banlieue bordelaise. Sur la thématique du voyage, le salon a accueilli 7000 visiteurs et visiteuses, rien que le samedi. L’occasion d’échanger avec Natacha Vas-Deyres, présidente du salon, et initiatrice du projet.
Voici la retranscription de notre échange
Bonjour Natacha.
Bonjour Allan.
Nous sommes ici à Hypermonde et je voulais d’abord te poser la question: Quel a été ton parcours un peu académique ?
Un parcours académique très classique parce que j’ai commencé, étant maintenant enseignante en classe préparatoire, mais avant, évidemment, par toutes les autres strates de l’éducation nationale, c’est-à-dire professeur de collège, professeur de lycée, puis enseignante aussi à l’université pendant 20 ans, donc en tant que chargée de cours. Et puis là, je pense que je vais terminer ma carrière en classe prépa.
Donc, j’ai fait un parcours très classique, études universitaires jusqu’au DEA à l’université Bordeaux-Montagne. Dea, c’est l’équivalent du Master 2, il y a maintenant quelques années. Et puis ensuite, j’ai passé le CAPES, l’agrégation, le doctorat, avec une thèse quand même en particulier, parce que la petite singularité, c’est que mon directeur de thèse m’avait proposé une thèse sur François Mauriac. J’avais publié quelques articles sur Mauriac et je me dirigeais vers évidemment une spécialité littérature du XXe siècle. Il m’a dit : On pourrait faire une thèse sur Mauriac. Et puis là, j’ai dit non. J’ai dit non parce que beaucoup de gens ont écrit sur François Mauriac et je me voyais pas travailler quatre ans encore sur un seul auteur. Je me suis dit : non, moi, je veux travailler sur la science qui est ma passion depuis que j’ai neuf ans.
Je lis de la SF, pas mal d’ouvrages depuis mon enfance. Je suis partie sur une friche de recherche qui était la science-fiction française. Quand je dis recherche, attention, ça ne veut pas dire qu’il n’y avait rien sur la science-fiction française, mais simplement qu’il n’y avait rien dans le champ académique. Je suis partie, donc j’ai mis cinq ans pour faire cette thèse qui qui s’appelaient Ces Français qui ont écrit demain.
J’ai travaillé sur à peu près 450 romans. J’en ai sélectionné à peu près 250, donc des auteurs français des années 1880 à 2004, puisque j’ai passé ma thèse en 2007. Donc, 2004, c’était vraiment l’ultra contemporain, ce qui m’a permis de parler d’à peu près quatre ou cinq générations d’écrivains et d’autrices françaises.
Suite à ça, après plusieurs années de tentatives pour intégrer l’université en tant que maître de conférence, ça n’a pas fonctionné. Ça n’a pas fonctionné pour une raison bien simple, c’est que la science-fiction, c’est une recherche qui est transversale. C’est-à-dire qu’académiquement, ça traverse plusieurs domaines. Pour mon cas, c’était la littérature, le cinéma, les sciences. Je participe à un programme de recherche avec le laboratoire d’astrophysique de Bordeaux. Ce programme s’appelle Origins, avec mon collègue de Frank Selsis. Je crois que sur un CV universitaire, c’est quelque chose qui est difficilement compréhensible par les membres de l’université qui ont une vision extrêmement classique d’une carrière. Comme ça n’a pas fonctionné, je me suis dit…
Et j’en avais discuté avec plusieurs personnes et amis autour de moi sur Bordeaux. On s’est dit: On va créer un festival. C’est devenu ma vie. C’est-à-dire que de la recherche académique, évidemment, j’avais été modératrice pour les Imaginales pendant de longues années, les Utopiales également. Stéphanie Nicot, que je salue en particulier, m’a complètement coachée, informée sur la création d’un festival. Dans la foulée, j’avais organisé, , co-organisé, parce qu’on est quand même plusieurs, mais j’ai co-organisé les deux conventions sur Bordeaux, celle de Gradignan en 2016 et celle à Bergerac en Dordogne.
Il y avait vraiment cette volonté d’insuffler une véritable dynamique culturelle de l’imaginaire dans la région Nouvelle-Aquitaine. J’y tenais parce que j’ai des origines en Dordogne, en Périgord, pas que la Gironde, pas que Bordeaux. Il fallait aussi apporter un peu de cette culture de la science-fiction dans le pays de mon cher Michel Jeury. Je dis mon cher parce que j’ai beaucoup travaillé sur Michel Jeury et aussi parce que Régis Messac, qui a créé les Hypermondes, la collection des Hypermondes, dans les années 30, il est né en Charente.
Donc, en Nouvelle-Aquitaine, on a un vrai terreau de l’imaginaire et bizarrement, on n’avait pas de festival. Donc, j’ai réuni tous mes collègues, donc, chercheurs avec qui je travaillais, les universitaires, et on a donc insufflé vie à ce projet de créer le festival. Et aujourd’hui, on a reçu 7 000 personnes dans la journée (Note : chiffre de la seule journée du samedi). Donc, je crois que c’est une belle réussite
On sent dans la façon dont tu en parles une vraie passion, quand on regarde aussi ton parcours et tout ce que tu as fait pour littérature d’imaginaire, on a envie de te poser une question: pourquoi la SF ? Pourquoi la science-fiction ? Parce que la science-fiction, pour moi, d’abord, ça m’a toujours fait rêver et même parfois cauchemardé. Mais je pense que c’était un frisson assez délicieux parce que j’ai toujours aimé le surnaturel. C’est à dire que, parfois, j’ai un peu de mal avec la réalité et je pense que depuis que je suis enfant, j’avais une imagination absolument débordante et j’avais besoin d’avoir plusieurs mondes à ma disposition. Pour rêver, pour imaginer, pour essayer, effectivement. Ce n’était pas du divertissement, c’était extrêmement profond, parce que je crois que j’avais une dizaine d’années quand j’ai lu Les Chroniques Martiennes de Bradbury.
Je le dis souvent, il y a deux œuvres qui m’ont vraiment marqué. Les Chroniques Martiennes de Bradbury, qui est une science-fiction quasiment poétique. Et puis aussi une fascination pour le voyage dans le temps et une sorte de voyage dans les civilisations. Et par exemple, Demain les chiens de Simak, que j’ai lu aussi à 10, 11 ans, ça a été une révélation absolue. C’est-à-dire le fait de se dire que les animaux avaient effectivement la possibilité d’être aussi intelligents que l’humain, que les fourmis aussi, les insectes. J’ai beaucoup travaillé sur les fourmis, les insectes.
J’adore imaginer, essayer de travailler sur les sociétés insectes, parce que je suis persuadée qu’il y a une intelligence que nous ne sommes absolument pas capables de percevoir. Donc, dans tous les écrits que j’ai pu produire sur les insectes et sur l’imaginaire des insectes, je crois que c’est très présent. Et donc cette imagination, cette perception d’intelligences différentes, chez les extraterrestres aussi, bien sûr, c’est quelque chose qui m’a totalement fasciné. Et puis, j’ai eu un grand-père aussi qui était directeur de la Warner Bros à Bordeaux. Du temps, c’était il y a très longtemps, dans les années 70, qui était directeur de l’agence française de la Warner Bros.
Je le dis très simplement, mais on allait au cinéma gratuitement. Donc, j’allais au cinéma deux, trois fois par semaine depuis que j’étais toute petite. J’ai vu les premiers Spielberg, j’ai vu tous les grands films de science-fiction. Je me rappelle avoir vu la première de Superman avec Christopher Reeves, dont je suis une fan absolue. Tout ça fait que toute cette espèce de terreau, des parents très ouverts d’esprit, on a énormément voyagé, tout ça a fait que c’était, je pense, une sorte de terreau très fertile pour que le goût de la science-fiction se développe en moi. Et j’en ai toujours eu. Je pense que ce qui est vraiment important, c’est que quand j’ai eu à travailler académiquement, c’est-à-dire quand j’ai passé le CAPES, l’agrégation, qui sont des temps très intenses intellectuellement, où on travaille sur des œuvres qui ne sont pas forcément à notre goût. En même temps, parallèlement, j’avais besoin de relire des grands classiques. Par exemple, pendant le CAPES, où je n’avais absolument pas que ça à faire, j’ai lu deux cycles. J’ai lu tout le cycle des vampires d’Anne Rice et j’ai relu Fondation, tout le cycle de fondation d’Assimov. J’ai eu l’impression qu’en même temps, ça me portait intellectuellement pour réussir ces épreuves.
Je me suis dit: Il n’y a pas que Rousseau, il n’y a pas que Rabelais dans la vie. Il y a aussi Anne Rice, il y a aussi Asimov, il y a tous ces auteurs-là qui étaient derrière moi, qui étaient en moi et qui m’ont boosté.
Je crois avoir compris aussi qu’il y avait une appétence particulière pour l’utopie, la dystopie. Est-ce qu’on a vu une évolution de ces genres-là depuis 1984, Le Meilleur de monde, etc
Ce qui m’a intéressé dans l’utopie, c’est d’essayer de percevoir quand avait eu lieu le basculement par rapport au réel.
Parce que l’imaginaire utopique existe depuis quasiment l’Antiquité. C’est-à-dire que les grands auteurs, aussi bien par exemple dans le Moyen Âge, ça s’appelait, c’était différent, mais il y avait des utopies.
Le roman de la Rose, par exemple, est une utopie. Toutes les scènes dans, je dirais, la légende arthurienne, qui font référence à une sorte de pays de cocagne, ou d’ailleurs dans d’autres œuvres médiévales, ce sont des utopies. Donc, c’est un courant, c’est une veine littéraire qui est vraiment qui est sous-jacente et qui permet d’irriguer l’imaginaire collectif, politique.
À partir du XVIᵉ siècle, ça s’est érigé en genre littéraire, avec Utopia de Thomas More, la meilleure des républiques, comme il le dit lui-même, ou la meilleure forme de gouvernement, en 1516, donc on était au tout début du XVIᵉ siècle. Et à partir de là, on a tout un massif, un corpus d’utopies qui ont essayé de proposer des modèles politiques différents. Et ça fait vraiment avancer la réflexion politique avec un temps de retard. Parce que l’imaginaire, quel qu’il soit, a toujours un temps d’avance sur le réel et la réalité politique. Et justement, pour la dystopie, ce qui est absolument incroyable, c’est qu’il y a des germes dystopiques dès le XIXe siècle.
C’est-à-dire à partir du moment où la la révolution industrielle se met en place. La dystopie se met aussi en place. C’est-à-dire que ce monde idéal porté par une économie capitaliste industrielle, qui elle aussi, je veux dire le libéralisme économique, a été une utopie au départ dans sa création, très, très vite, va tourner aussi au cauchemar dans le réel. Et là, on a un basculement qui s’effectue puisque les utopies disparaissent du champ littéraire et apparaissent aussi après au cinéma, mais beaucoup plus tardivement.
Mais les dystopies commencent à investir le champ de l’imaginaire, on va dire, dans les 20 dernières années du XIXᵉ siècle et vont littéralement exploser dans les 20 premières années du XXᵉ siècle. Pourquoi elles explosent ainsi ? Du fait de l’utopie communiste, entre guillemets, à partir de 1917, avec des germes, évidemment, à partir de 1905, donc tout début XIXᵉ siècle, mais cette utopie-là devient bien réalisante, c’est-à-dire qu’elle se réalise dans le réel et, de manière totalement inversée, la dystopie, à ce moment-là, donc, en 1917, 1920, c’est les premières très, très grandes utopies, je pense à Nous autres, par exemple, de Zamiatine, se créent à partir du moment où le communisme est dans le réel, mais devient cauchemardesque.
Donc l’imaginaire dystopique, à ce moment-là, va prendre le relais. On a la réversibilité qui se met en place d’un point de vue de la littérature pour exprimer cet imaginaire qui, d’idéal, devient cauchemar.
Aujourd’hui, il y a quand même tout un courant de la SF qui dit: Il faut arrêter avec les dystopies. Il faudrait apporter un peu d’espoir. Quand on aime cette littérature-là, est-ce que c’est aussi quelque chose qui résonne de dire: Aujourd’hui, on a besoin de futurs chantants ?
Oui, tout à fait. Parce que je pense que d’abord, les auteurs se complaisent un petit dans la tragédie. Mais ça, ce n’est pas nouveau. Si vous prenez des gens comme Racine ou comme Corneille, les auteurs très classiques au XVIIe siècle, c’est beaucoup plus facile de faire de la tragédie que de la comédie. Le seul qui est vraiment réussi dans qui, évidemment, traverse les siècles, en partie, c’est Molière, mais la comédie est beaucoup plus difficile. Je pense que l’utopie est beaucoup plus difficile que la dystopie.
C’est-à-dire que cette espèce d’imaginaire cauchemardesque, c’est aussi du pain béni pour le récit, c’est-à-dire pour mettre face à face des forces opposantes qui sont un véritable booster du récit, des personnages, des conflits entre les personnages. C’est ce qui va faire avancer le récit. Je dis souvent quand je fais des conférences grand public: Si vous n’avez pas de méchant dans une histoire, ça ne fonctionne pas. Star Wars, par exemple, toute la saga Star Wars sans Dark Vador. En fait, qu’est-ce qui nous fascine ? L’histoire de Luc est intéressante, certes, Mais en fait, le fil rouge de cette histoire-là et de la saga, c’est l’histoire de Dark Vador, c’est l’histoire d’un méchant.
C’est-à-dire que cette dimension de cauchemar qui amène à des conflits, à des oppositions entre les de son âge, elle est extrêmement dynamique dans la création du récit. Quand vous revenez à l’Utopie, l’Utopie, c’est un monde où tout est censé aller bien. Donc, il y a beaucoup moins de dynamique en termes de récit. Et Wells, par exemple, disait que l’utopie, c’était très statique d’un point de vue – J’utilise un mot universitaire, de la diésèse, d’un point de vue du récit.
Donc, d’une part, il faut que les auteurs arrivent à dépasser, c’est-à-dire à trouver une bonne histoire pour nous raconter de l’utopie. Ça, c’est un point de vue littéraire. Et d’autre part, je crois qu’il faut qu’eux-mêmes soient finalement dans l’espérance. C’est ce qu’un grand spécialiste de l’utopie, Ernst Bloch, appelait le principe espérance de l’utopie. Et ça, ce n’est pas si évident que ça, parce que les auteurs sont des auteurs et autrices. Et quand on discute, par exemple, avec Catherine Dufour, avec Pierre Bordage, avec Serge Lehman, nos grands auteurs de l’imaginaire et de la science-fiction. Ils m’ont tous dit que c’était très difficile d’imaginer une utopie. Et je me rappelle, en 2022, on a demandé à tous les auteurs, évidemment les nouvelles générations, d’écrire des nouvelles utopiques, puisque le thème, c’était utopie dans une festival hyper monde.
Et beaucoup ont refusé ou ont eu énormément de mal à écrire leur texte parce que leur esprit, finalement, ne se projetait pas dans ce principe espérance. Et c’est Claire Duvivier, qui est une nouvelle voix de l’imaginaire français, qui a eu d’ailleurs le Grand Prix de la Nouvelle Francophone pour sa nouvelle dans notre anthologie Hypermonde, qui a réussi, je pense, entre autres à écrire. Elisabeth Vonarburg nous a écrit une nouvelle Solar Punk, mais elle m’a bien dit : ça a été particulièrement difficile parce qu’il faut qu’ils arrivent finalement à tordre et à rendre leur esprit réversible par rapport à la dystopie.
Donc, c’est complexe pour un auteur de se projeter. Et puis, troisième point, les auteurs ont bien compris que Ils habituaient leur public à des futurs noirs, à des futurs post-apocalypse. Ils se sont dit: Puisque tout le monde est habitué, on les a habitués à ces visions-là, il va falloir les habituer à des futurs beaucoup plus désirables. C’est-à-dire qu’il va falloir relancer le principe espérance. Bien sûr, le réchauffement climatique ou le changement climatique, maintenant, il est sur nous. Qu’est-ce qui va se passer ? Il faut faire confiance aux scientifiques.
Il faut regarder notre futur en face. Ce n’est pas évident parce qu’on a des enfants. Ça veut dire que nos enfants, si on a dépassé la cinquantaine, on sait que notre vie n’est pas tout à fait terminée, heureusement, mais une grosse partie de notre vie est passée. Nos enfants qui sont tout jeunes, qui ont 15, 20 ans, voire qui sont plus petits, on va les amener dans ce monde-là. Et ce monde-là, il va falloir, comme dit Pierre Bordage, il faut regarder nos monstres en face et il faut regarder ce changement climatique en face, vraiment. Et les auteurs peuvent nous aider par rapport à ça. Changement énergétique, nous habituer à une société qui ne sera pas une société de consommation, pour qu’on puisse retrouver finalement de la vie et de l’espérance dans notre monde. Mais c’est possible. Nous avons vécu déjà, en dehors du capitalisme, nous avons déjà vécu dans des sociétés où nous avions beaucoup moins. Évidemment, les gens ont été parfois très misérables, pas dans des sociétés démocratiques, bien sûr. Mais moi, je crois que c’est possible. Mais il va falloir que l’imaginaire collectif produise des éléments culturels qui nous permettent de se dire: Oui, c’est possible.
Et si on parle d’éléments positifs, on reboucle sur Hypermonde. Moi, c’est la première fois que je fais ce festival. On sent énormément d’énergie positive, on sent énormément d’échanges et c’est ça le but d’un salon ?
Quand nous l’avons créé, Hypermonde, on est partis sur des principes. Parce que pour avoir des subventions, là, je vais rentrer un peu dans la machine créative, dans la technique. Pour avoir des subventions, il faut écrire un projet. Nous avons écrit collectivement un projet. J’insiste là-dessus parce qu’Hypermonde, même si je suis évidemment présente là ce matin en tant que représentante de l’association et présidente, mais Hypermonde, c’est vraiment un projet collectif au départ, c’est-à-dire qu’avec des gens très différents, des profils tout à fait différents.
On a des gens qui viennent du monde de la communication, du monde de l’entreprise, du monde des jeux, des auteurs, des éditeurs, donc des gens qui appartiennent quand même au milieu économique, mais également des étudiants, des retraités, c’est intergénérationnel, et puis des chercheurs, des auteurs qui ont évidemment intégré l’aventure. On s’est dit: Il faut écrire. Qu’est-ce qu’on veut pour Hypermonde ? D’une part, la valorisation de l’imaginaire. Mais attention, une valorisation qui intègre le milieu académique. Parce que nous, on est persuadé que pendant très longtemps, en France, la science-fiction a eu mauvaise presse, parce que le milieu académique ne s’y est pas intéressé. Donc, en intégrant des scientifiques qui en étaient grands, des universitaires, des sciences humaines, c’est très bien passé.
Donc, parler sérieusement. On a par exemple, cette année, Alain Musset, qui est géographe, qui est un immense fan de Star Wars, qui, lui, utilise la fiction pour dire: Mexico, ce n’est pas Mexico. Vous l’avez par exemple dans la description de Coruscan, de Star Wars. Il analyse les éléments géographiques, scientifiques à partir de la fiction, même si c’est la fiction. Ça peut poser évidemment un problème méthodologique, mais ça existe. C’est exactement ce qu’on voulait faire à Hypermonde, c’est-à-dire parler au public sérieusement de l’imaginaire, mais tout en restant dans le divertissement. C’est-à-dire que c’est quand même la science-fiction et l’imaginaire, parce qu’on a aussi de la fantaisie et du fantastique. Ça fait rêver beaucoup de gens, donc il ne faut pas perdre ça. Nous, on a dit: Il faut que le sense of wonder, la merveille de l’imaginaire, soit vraiment présente aussi au cœur des hypermonde.
Quand je vois, par exemple, cette année, on a fait venir une DeLorean, qui a été d’ailleurs financée par du mécénat, des entreprises qui comprennent quand même les bienfaits de l’imaginaire sur le grand public. Je me dis : bien sûr que ça fait rêver les gens. C’est le voyage temporel. DeLorean, c’est Retour vers le futur, c’est une des grandes sagas de la pop culture cinématographique.
Donc, ça fait rêver les gens. C’est ça qu’on voulait, c’est-à-dire à la fois faire réfléchir les gens de manière la plus agréable possible, mais aussi les divertir. Ça, c’est au cœur vraiment de notre démarche. Ça crée de l’émulation Les gens repartent, ils sont heureux. On a une ambiance très bon enfant. Aussi, on s’est dit, le deuxième point très important, et ça a été aussi un des points de partenariat avec la mairie de Mérignac, il faut que on parle aux plus jeunes, il faut qu’on parle aux familles et il faut aussi qu’on soit dans l’intergénérationnel. Vous avez vu, hier, on a un public qui est complètement intergénérationnel. C’est-à-dire qu’on a des gens, bien sûr, qui adorent la SF et qui ont entre, on va dire, entre 45 et 55 pour parler de segment. Mais nous avons aussi beaucoup d’enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup d’ados, beaucoup de jeunes adultes qui vient Ça, pour nous, c’est une vraie réussite.
C’est-à-dire qu’on parle à l’ensemble de la population et des gens qui viennent de plus en plus tous les ans. On a une progression d’à peu près 2 000 personnes par an qui viennent sur le festival. Et on essaie de garder quand une ambiance détendue pour que les gens ne se sentent pas oppressés parce qu’il y a trop de monde.
Ça, c’est quelque chose qui est très important pour nous.
Merci beaucoup, Natacha, pour cet échange. Bravo pour Hypermonde. Encore une fois, je passe un très bon moment parmi vous.
Merci beaucoup pour cette interview. Et puis, longue vie aux Hypermonde.
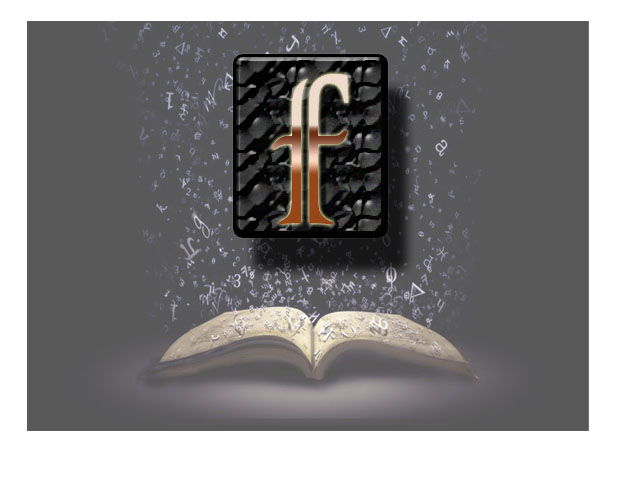

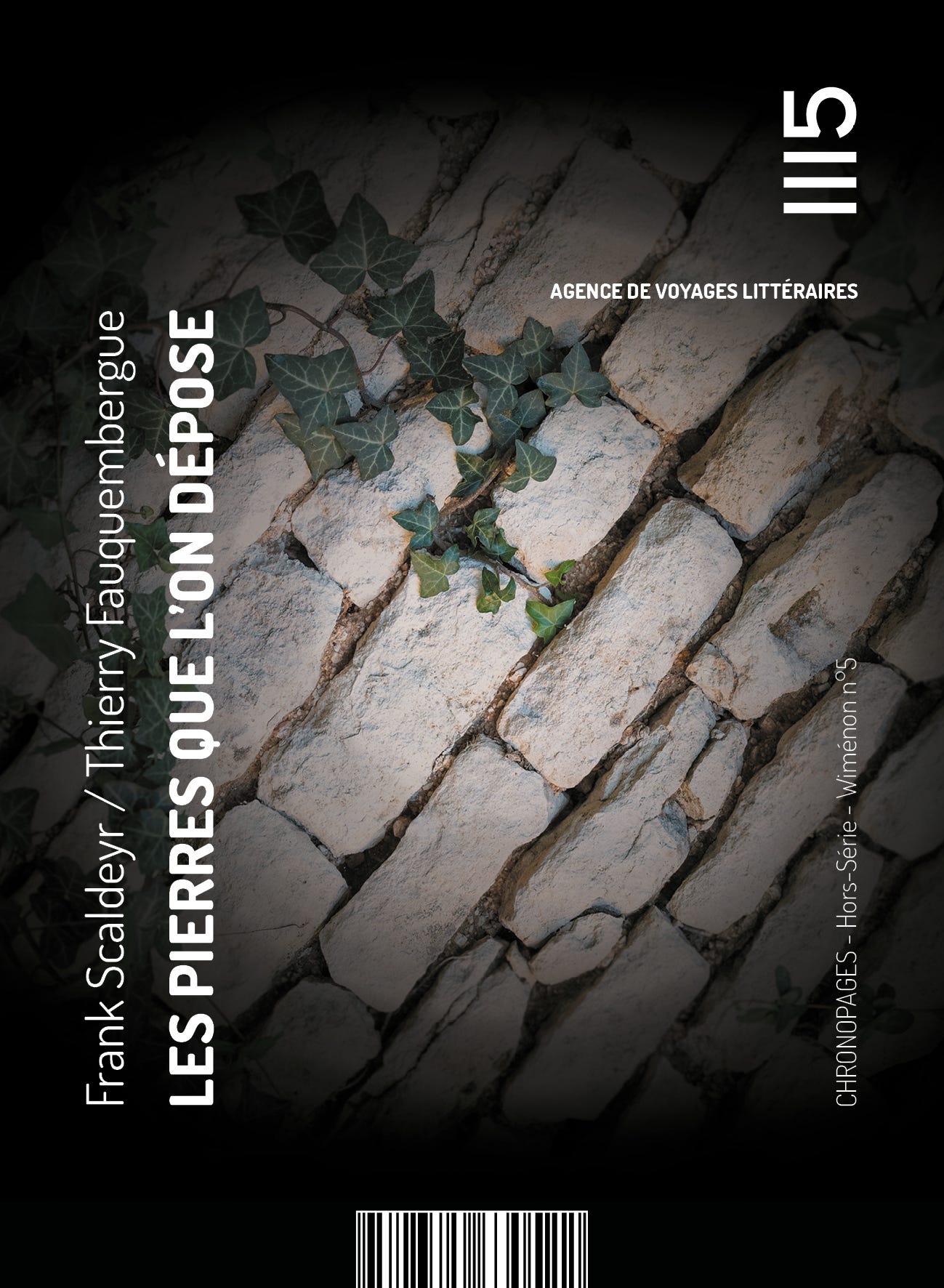

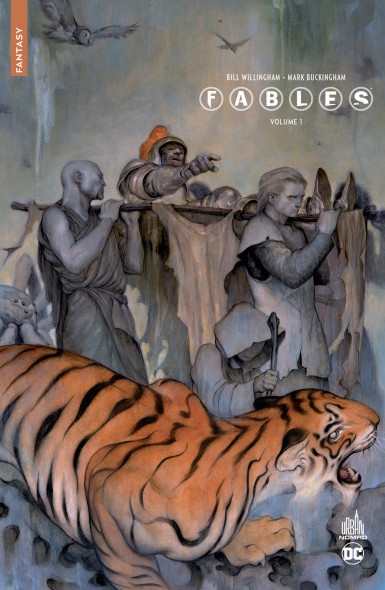







Laisser un commentaire