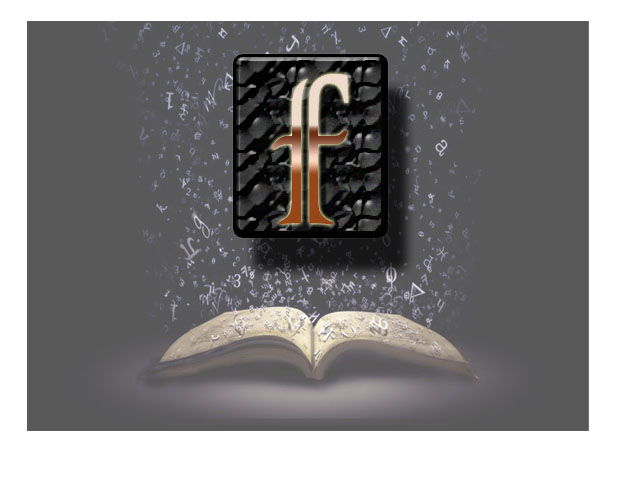Lorsque j’ai eu la chance d’interviewer Elisabeth aux Utopiales, c’était avant qu’elle ne reçoive le Prix Extraordinaire des Utopiales 2018. Et quand on voit le parcours de l’auteurice, cela semble totalement justifié tant par rapport à ses propres écrits qu’à l’action qu’elle a eu et continue d’avoir pour les littératures d’imaginaire au Québec.
Cette interview est donc l’occasion d’en savoir plus sur son parcours et sur les littératures de l’imaginaire de nos amis québécois.
Je vous remercie, Elisabeth, d’avoir accepté ces quelques questions. Comment vous présenteriez-vous ?
Je suis quelqu’un qui écrit des livres longs et complexes que les gens trouvent longs et compliqués. Certains aiment ça, d’autres non (rires). Je les écris pour moi d’abord, car j’ai besoin d’écrire, c’est comme respirer, et disons que si je n’écrivais pas. je serais morte. Donc je suis une écrivaine.
Ecrivaine, autrice ?
Ecrivaine. Sinon, autorice.
Un terme nouveau ?
J’essaie de l’utiliser. Plus ou moins systématiquement. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Ça me permet d’inclure le masculin dans le féminin puisque cela vient du latin “Autor”. Alors je mets au féminin, “autorice”, et le masculin est compris dans le féminin, hop.
Vous êtes arrivée dans les années 70 au Québec, à une époque où la science-fiction québécoise n’existait pas…
On avait de la proto-science-fiction, quand même, on avait eu des textes. Si vous aviez fait cette entrevue avec mon collègue et ami Jean-Louis Trudel, il vous aurait dit qu’il y avait eu de la science-fiction au XIXème siècle comme en France, comme partout : des précurseurs qui ne savaient pas parce que la tournure d’esprit qui consiste à imaginer ce qui pourrait être n’est pas une exclusivité de notre siècle. Mais la science-fiction moderne, consciente d’elle-même, consciente de ce qu’elle fait, consciente du milieu, consciente des milieux voisins, ne commence à exister au Québec qu’au début des années 70 avec la revue Requiem qui a commencé à faciliter l’agrégation des amateurs. Ça s’est concrétisé de façon définitive en 1979 avec la première convention de science-fiction que j’ai organisée à Chicoutimi.
À ce moment-là, la revue a changé de nom pour s’appeler Solaris. A partir du moment où on a une convention et au moins une revue — il y avait aussi des revues comme Imagine… et des fanzines –, on a une écologie suffisamment complète pour parler de science-fiction moderne. Nous y sommes arrivés tard mais je pense que nous avons pas mal rattrapé notre retard.
Et aujourd’hui ?
Elle se porte très bien, la SF québécoise. Nous en sommes à la quatrième génération d’auteurs, beaucoup de femmes aussi. Une des caractéristiques chez nous, c’est que nous avons toujours été œcuméniques, c’est-à-dire que science-fiction, fantasy, fantastique, gore… tout était légitime : il n’y a pas eu, par exemple, comme dans les années 80 ou 70 en France, un rejet de la fantasy. On a toujours considéré que les genres de l’imaginaire sont les genres de l’imaginaire quel que soit le genre privilégié, et donc on se porte très bien, je trouve. Malheureusement, je trouve aussi que l’écologie du milieu s’est un peu raréfiée, comme si elle imitait la nôtre. Certaines espèces ont disparu… les fanzines, en gros. Et c’est embêtant pour la création parce que nous avons une revue professionnelle et demie… nous sommes des professionnels parce que nous payons, les auteurs, les articles, les dessinateurs.
Une des caractéristiques chez nous, c’est que nous avons toujours été œcuméniques, c’est-à-dire que science-fiction, fantasy, fantastique, gore… tout était légitime : il n’y a pas eu, par exemple, comme dans les années 80 ou 70 en France, un rejet de la fantasy
La “demie”, c’est Brin d’éternité, je ne crois pas qu’ils paient les auteurs, ou peut-être ? Elle est de qualité professionnelle aussi, en tout cas. Donc disons que nous avons deux revues. Solaris étant la plus ancienne est plus exigeante et notre problème c’est que nous ne pouvons plus publier de jeunes auteurs débutants. L’écologie littéraire normale serait de s’appuyer sur des fanzines, où on commence à publier des textes perfectibles ; les gens qui s’occupent du fanzine débutent aussi, ce ne sont pas forcément des directeurs littéraires patentés et diplômés, donc on apprend des deux côtés, ensemble, on évolue ensemble… Les fanzines permettent aux jeunes auteurs de commencer : ils essaient, ils essuient les premiers plâtres et puis ils apprennent et à mesure qu’ils apprennent, ils peuvent passer à l’étape suivante et à la fin ils peuvent publier de façon professionnelle… C’est comme ça que cela devrait se passer. À moins d’être un super-génie sorti de nulle part qui vous pond une nouvelle parfaite du premier coup, mais c’est extrêmement rare. Par exemple la nouvelle d’Yves Meynard qui s’appelait Sans Titre. Il avait dix-huit ans et on l’a publié tel quel mais cela arrive 1% du temps.
C’est ce que nous avons fait avec Requiem depuis 1973 / 1974, évoluer ensemble, mais nous sommes passés professionnels au niveau de la direction littéraire à partir du moment où nous sommes devenus Solaris et donc en 1979. Et ce n’est pas parce que j’étais la directrice littéraire (rires). On n’a jamais eu une direction littéraire unique, elle a toujours été collégiale, ce qui est plus intéressant : ce n’est pas un comité. Si on a un problème avec un texte, on dit “regarde ce que j’ai reçu et que fait-on avec ça ?”.
Donc le problème présent est qu’on ne peut pas publier assez de textes et donc l’écologie du milieu est un peu handicapée de ce point de vue. Parce que Brin d’éternité ne suffit pas à la tâche. Comme eux, on a une publication trimestrielle et en plus on essaie de publier un auteur français et un auteur anglais en traduction. La place pour les nouveaux auteurs existe mais moins que ce qu’on voudrait.
Quand je suis sur le jury du prix Solaris, je vois plein de textes qui seraient travaillables, mais on a des nouvelles à publier pour l’année entière et seulement quatre numéros. Or les gens veulent être publiés maintenant, ils veulent voir un public maintenant et on ne peut pas leur garantir qu’ils vont être publiés avant un an et demi. Ce n’est pas bon pour eux, pour leur écriture : certains attendent d’être publiés avant de continuer à écrire. Donc, c’est un problème.
Si on regarde les auteurs contemporains québécois, lesquels vous nous conseilleriez de suivre ?
Il y a dans les autorice, il y a Sylvie Bérard qui est ici aux Utopiales… C’est ce cas rare de professeur de littérature capable d’écrire et qui a un imaginaire plutôt tordu, qui écrit des choses extrêmement provocantes et qui les écrit bien.
On peut citer aussi, dans la même génération, Philippe-Aubert Côté, qui sort d’un de mes ateliers d’écriture et j’en suis très fière ; Ariane Gélinas, qui écrit essentiellement du fantastique…
Dans la génération d’avant, il y a Yves Meynard, Francine Pelletier… Et maintenant il y a Karoline Georges
Je constate
qu’il y a beaucoup d’autorices dans les noms que vous citez ?
Les gens veulent être publiés maintenant, ils veulent voir un public maintenant et on ne peut pas leur garantir qu’ils vont être publiés avant un an et demi.
Oui. Il y a toujours eu pas mal de femmes dans la littérature de genres au Québec… Dès le début, il y avait Esther Rochon et moi.
Mais aussi : Héloïse Côté qui écrit de la fantasy, Natacha Beaulieu qui écrit du fantastique. Bien sûr Alain Bergeron, qui était notre cas car il a publié avant tout le monde, il avait publié en feuilleton dans le Soleil de Québec qui était le journal de la ville de Québec un roman qui s’appelait Un Été de Jessica que j’ai relu récemment pour une critique dans l’Année de la science-fiction et du fantastique québécois. (on est dans les années 70 et on comble les trous de la série) ; je parle ici d’un texte de 1975 ou 1977 et qui n’a pratiquement pas pris une ride. On se demandait d’où il venait : l’auteur avait visiblement lu beaucoup de science-fiction ; on l’a rencontré au premier congrès et on l’a récupéré dans le milieu. Un gars qui était un peu pas mal scientifique sur les bords. Il a écrit des nouvelles et un roman, Phaos qui est un peu cyberpunk ; il a aussi obtenu un prix international de la meilleure uchronie pour une novella, Le huitième registre.
On a donc pas mal de monde qui vaut la peine du détour et je n’oublierai pas Jean-Louis Trudel qui a publié moins de livres chez Alire mais en a beaucoup publié au Fleuve Noir et aussi énormément de nouvelles et de romans pour jeunes ( ou “jaunes adultes”) aussi.
Et si nous revenons désormais à votre travail, cette année, c’est une nouvelle trilogie, Les Pierres et les Roses chez Alire. Comment vous le présenteriez ?
J’ai l’habitude de dire que c’est un roman de capes et d’épée, avec un clin d’œil. Je n’écris pas de romans de capes et d’épée. Je dis aussi que c’est une histoire d’amour – avec un clin d’œil car je n’écris pas non plus d’histoires d’amour. Il n’y en a pas une, mais quatre histoires d’amour (et d’histoires tout court) dont une suggérée. Mes personnages sont des personnages humains qui ont tout : des problèmes, des traumatismes enfantins… et des histoires d’amour. Ils baisent, ils vont aux chiottes, ils mangent : ils ont un corps.
Si je ne me trompe pas, il y est beaucoup question de religion ?
Il n’est pas forcément beaucoup question de religion, mais cela se passe dans un univers à une époque, un moyen-âge (le XIIIème siècle) où il serait aberrant de ne pas parler de religions. Les religions, au pluriel. C’est ma façon d’en parler de façon détournée, parce que je ne suis pas capable d’en parler ici et maintenant dans mes histoires de science-fiction pure, c’est trop près. Il me faut une distance pour pouvoir en parler. Un monde inventé, parallèle, existe avec tout ce qui existe dans un monde : il y a de la politique, de la religion, de l’économie, les histoires qu’on raconte aux enfants pour les endormir ou les socialiser, il y a les coutumes liées aux calendriers, il y a la façon dont on s’habille, il y a la façon dont on recycle la merde humaine, il y a tout dans un monde. Et ne pas parler de religions me paraîtrait stupide – et invraisemblable, d’autant plus que c’est un univers parallèle et que le point de divergence par rapport au nôtre est le fait que Jésus a eu une sœur jumelle qui s’appelle Sophia.
À eux deux, ils ont créé la religion géminite, qui n’a pas grand rapport avec ce que nous connaissons. C’est une religion de l’harmonie, une religion un peu taoïste, d’une certaine façon. Genre, nous sommes femmes et hommes et devons reconnaître cette bipotentialité en nous. Jésus en nous comme Sophia en nous, en tant que principe masculin et principe féminin avec la place pour l’homosexualité, masculine et féminine. Mais ça, on en parle moins au XIIIe siècle. On en parle plus dans la série de Reine de Mémoire qui se passe cinq à six cents ans plus tard.
Oui il est question de religions, il est question de politique, il est question de conflits armés puisqu’on a, en gros, “le nord” et “le sud”. Une grande partie du Nord est christienne, c’est-à-dire la religion qui s’est séparée par schisme du géminisme et qui a un point de vue complètement opposé sur la magie. La religion géminite est fondée sur le fait que Jésus avait des pouvoirs, tout comme sa sœur et ses disciples – et c’est un univers parallèle où la magie fonctionne. Il y avait de la magie avant eux mais leur magie était plus puissante et a remplacé la magie ancienne. À un moment donné, et c’est évoqué à travers à la trilogie, des Géminites ont commencé à dire qu’ils rejetaient la magie, et ils n’aimaient pas non plus le rôle donné aux femmes, puis ils se sont séparés. Ils brûlent leurs sorciers, ceux que les Géminites appellent “talentés” pour eux, Sophia était une sorcière, une suppote de Satan.
C’est encore la femme qui est la victime !
Oui, bien sûr ! C’est le but de la chose. Je voulais opposer une culture où la femme a un rôle pratiquement égal, ce qui n’est pas très évident non plus au XIIIème siècle, mais avec des nuances Il y a des nuances partout : Dieu est dans la nuance, tout comme le diable, et autant que dans les détails. Vous avez le Nord, donc, qui est christien et le Sud géminite. Les gens du Sud ont presque toujours gagné parce qu’ils ont des pouvoirs, chaque fois que les Christiens se lancent à l’assaut. Ils sont très évangélisateurs, les Christiens : ce sont des emmerdeurs prosélytes. Une des forces du géminisme c’est d’être œcuménique : il travaille de concert avec les religions qui vivent sur son territoire et les tolère sans problème si elles ne se font pas prosélytes. Vous pouvez pratiquer, vous avez des églises, des temples, des mosquées, vous avez votre système institutionnel religieux, avec vos prêtres et vos cérémonies, mais vous n’essayez pas de faire des convertis : si les gens se convertissent, il faut que ce soit d’eux-mêmes. Si les gens viennent vous chercher et sont curieux de votre religion, vous pouvez leur parler. Mais vous n’avez pas le droit d’aller les évangéliser à la pointe de l’épée et ce genre de choses, alors que les Christiens, c’est bien évidemment l’inverse. On est bien mieux accueilli quelle que soit sa religion dans le Sud que dans le Nord. Le Nord, c’est en gros l’Angleterre, l’empire anglais avec pour vassaux l’Aquitaine et la Bretagne, et des visées toujours repoussées sur l’Écosse et l’Irlande plus ou moins encore géminites, et l’empire hutlandais qui comprend l’Allemagne, la Hollande, les Pays-Bas et une partie de la Normandie et qui est en train d’essayer de bouffer les pays nordiques. On a un Richard Tête d’Or. C’est un univers parallèle, mais on peut se reconnaître, c’est le principe et le plaisir de l’uchronie. Bon, il y a eu la croisade qui a connu une alliance inouïe entre le Nord et le Sud. Le Nord par la voix de son vieux pape Albert a été convaincu de s’allier aux sorciers géminites parce qu’il faut délivrer Jérusalem, c’est trop important, on ne peut pas la laisser aux Perses, quand même ! Les Islamites sont aussi de la partie, du côté des Géminites, car c’est une variante religieuse (pas de schisme Shiite/Sunnites), de la même façon que Byzance est un empire et n’est jamais tombée. Sa religion orthodoxe est aussi une variété de géminisme. La Croisade a eu lieu au début de la série, et la coalition a gagné. Un nouveau roi est monté sur le trône anglais après la mort de Richard, qui a des ambitions politiques et conquérantes sur le Sud et il va donc y avoir des conflits.
À un moment où les extrémismes religieux percent, donner une sœur à Jésus n’est pas provocateur ?
Je m’en fous (rires). De toute façon, ce n’est pas la première fois car Reine de Mémoire se déroule dans le même univers. Personne ne m’a envoyé de fatwa, pas encore. C’est l’intérêt de ne pas être lue. (Rires).
Les Utopiales, ça représente quoi pour vous ?
Tout d’abord l’occasion de revoir les copains, parce que je ne les vois pas souvent. Je ne suis en relation avec le milieu de la science-fiction francophone et anglophone que par l’internet, car j’habite très loin de tout. Je n’ai aucun collègue SFF à Chicoutimi, où j’habite. Les copains sont au mieux à Québec ou à Montréal ou encore plus loin dans les villes canadiennes ou américaines – ou européennes. Du coup, Facebook est une bénédiction pour moi. Malheureusement ça ne m’apporte pas que les copains : il m’apporte aussi des nouvelles du monde, dont je me passerais tellement ! Mais c’est ma façon de rester en lien. Les Utopiales, c’est ça . Quand on est invitée, on n’a pas le temps de participer à énormément de choses, mais c’est une occasion de rappeler aux gens qu’on existe encore !
D’ailleurs, Alire est distribué en France ?
Oui. On peut acheter sur Amazon, ou à la Fnac. Ou commander en librairie. Mais Alire a un site sur lequel on peut acheter en format papier ou numérique. Tous mes livres sont en version électronique et j’en vends plus sous ce format, maintenant. Ce qui est normal, car ce sont des gros livres ; ils coûtent coûte moins cher en numérique.
Le dernier mot à l’invitée ?
Oups !