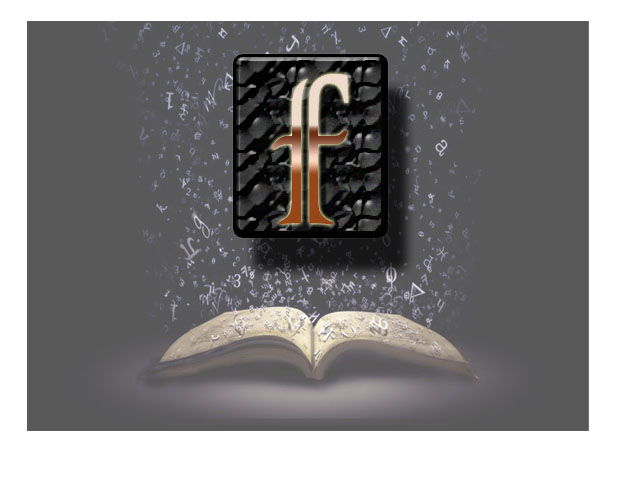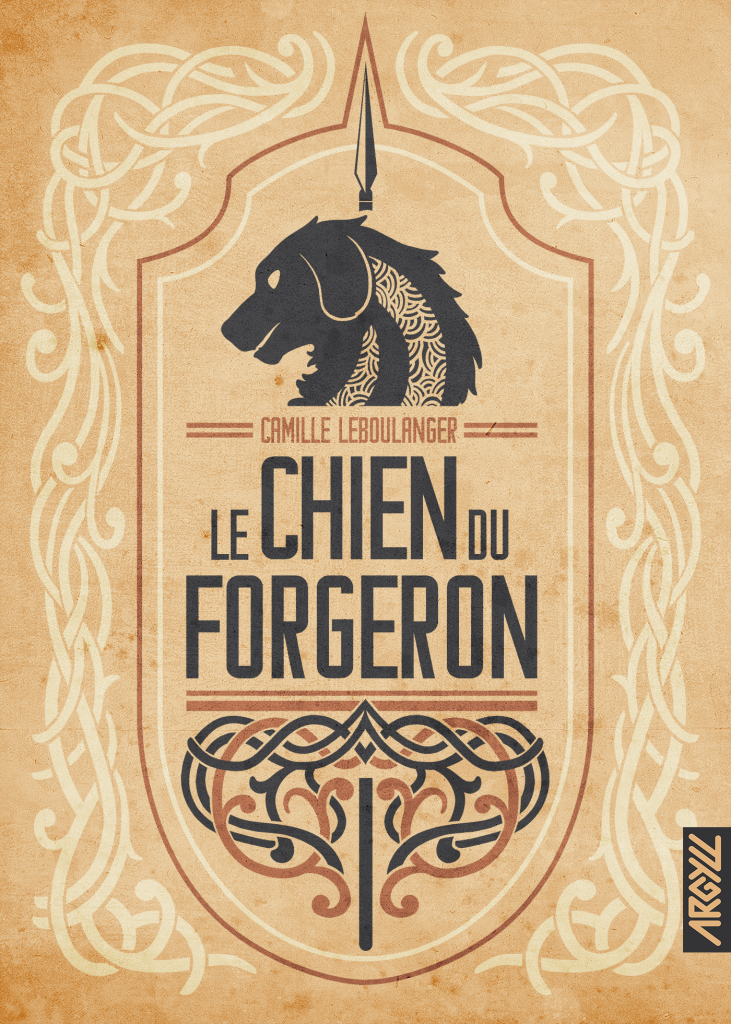L’actualité est double pour Camille Leboulanger cette année avec la sortie du Chien du forgeron aux éditions Argyll et Ru aux éditions L’Atalante. Et quoi de mieux que les Utopiales pour découvrir un auteur, notamment au travers des conférences, où j’ai pu découvrir l’engagement de l’homme / auteur.
L’occasion aussi de prendre le temps d’échanger sur ces deux romans et sur la place de l’écrivain dans la société.
Bonjour Camille, tu es déjà auteur de 5 romans dont 2 cette année, Le chien du Forgeron chez Argyll et Ru chez l’Atalante. Qui es tu ?
Je suis Camille Leboulanger, je suis auteur de 5 romans chez l’Atalante, Critic et Argyll. Les plus récents sont Ru et Le chien du forgeron et j’habite en Bretagne. J’ai 30 ans.
Je vais commencer par Le Chien du Forgeron, je me suis senti très bête, car dès le début de la lecture, j’ai eu La Tribu de Dana de Manau en tête… C’est aussi une référence ?
C’est une référence dans le sens où j’ai 30 ans et que 1997, 1998, j’ai pris Panique Celtique dans la gueule assez violemment, et c’est piste 9, Le Chien du Forgeron mon premier contact avec cette histoire. Ça m’est resté pendant des années. Pour rigoler, à la sortie du bouquin, j’ai enregistré ma vidéo avec La Tribu de Dana avec Argyll sur Youtube et donc, oui, on va dire que de mon côté ça vient de là.
On parle peu de mythologie celtique, notamment autour de Cúchulainn dont Panique Celtique est un des seuls à parler, en parlant d’un guerrier. Dans ton roman, finalement, tu casses énormément le mythe du héros…
Oui. On peut trouver pas mal de références à Cúchulainn en musique : une chanson des Pogues The Sick Bed of Cuchulainn ; un morceau de Jeff et Mychael Danna intitulé The Blood of Cu Chulainn.
Il faut revenir à la genèse du livre. Ce qui m’est venu, l’idée traînant depuis longtemps, c’est l’envie d’écrire quelque chose de plus facile et qui s’est révélé paradoxalement complexe. Je n’ai pas pu vraiment commencer à écrire avant d’avoir identifié le dispositif narratif avec le narrateur dans l’auberge qui veut raconter l’histoire. Une fois que j’ai su que je voulais que le premier signe typographique soit des guillemets qu’on ouvre et le dernier des guillemets qu’on ferme, j’ai pu me lancer dans cette histoire de parole.
Cette histoire de déconstruction et de critique, au sens littéral du terme et pas forcément négatif de la figure du héros, m’est venue de plusieurs sources qu’on trouve en bibliographie du bouquin : l’un que j’ai entendu sur France Culture que j’ai trouvé intéressant et un autre, grand spécialiste de l’Odyssée qui disait qu’il n’aimait pas beaucoup Ulysse, qui n’était finalement qu’un pillard. Ça m’a fait m’interroger sur le personnage de Cuchulainn que j’étais en train d’écrire.
Pour écrire sur ce personnage, j’ai bouquiné et lu les traductions canoniques que nous avons en France, des bouquins plus génériques sur la culture celtique et quelques bouquins sur la civilisation celtique du premier âge de fer et c’est un peu compliqué car il y a peu de sources.
Une fois que je me suis lancé là-dedans, je me suis rendu compte que je n’aimais pas beaucoup ce personnage inégal et négatif. En fait, ce qu’il s’est passé, étant entré en sociologie très récemment, c’est que je le prenais d’un point de vue sociologique : d’où il vient, quelle société il faut pour le déterminer, pour construire un personnage comme ça et pourquoi un personnage comme Cuchulainn advient, dans son éducation, dans sa culture… Qu’est-ce-que l’héroïsation d’une personne comme le Chien signifie ? D’un côté l’influence du milieu sur Le Chien et de l’autre l’influence du Chien sur son milieu. Le monde dans lequel il vit se transforme sous son influence. Comme le héros est censé être une cristallisation des valeurs portées par la société, si les valeurs de la société sont la violence physique, sexuelle, morale, l’impunité et globalement la phallocratie, cette société que ne peut être que phallocrate, violente. La société se dégrade sous l’influence du chien.
Paradoxalement, l’origine du mal, si on peut le dire comme ça, c’est l’oncle qui prévoit le mariage de sa sœur pour préserver la paix… L’enfer est pavé de bonnes intentions. Il voulait simplement sécuriser la paix en mariant sa sœur avec un autre seigneur. Finalement, c’est presque de ce fait et de ces conséquences de cette obligation de mariage que découle toute cette violence.
Je pense que de la violence naît la violence. On pourrait se poser la question de la violence au sens général car elle peut être dans certains cas légitime.
En tout cas, cette violence faite à Dechtire, la mère du Chien, et pour laquelle j’ai plusieurs théories, est à l’origine réelle du Chien.
Les rapports du Chien avec le narrateur sont volontairement restés mystérieux et j’ai mon idée sur ce qu’ils sont et ne les dévoilerai pas : le lecteur attentif pourra recoller les morceaux facilement ; en revenant sur le premier chapitre après avoir lu la fin, il comprendra les liens forts qui unissent le Chien au narrateur, qui ne sont pas que de l’ordre de l’affectif.
Je pense que c’est de cette violence – le mariage forcé, le viol conjugal – couplée aux ambitions déçues et accomplies de chacun des membres de ce couple, que nait le Chien.
Le couple de parents est mal assorti. Le père est volontairement un peu ridiculisé dans l’affaire: c’est le mari impuissant et déjà on est dans cette analyse de la virilité, car le mari impuissant est un stéréotype de la mythologie courante. Tu le retrouves dans le mythe d’Hercule, dans le fait qu’Hercule est un demi-dieu, que son père est humain, mais ce n’est pas vraiment son père, pareil pour le roi Arthur qui est issu d’un viol : le père d’Arthur se déguise pour posséder Ygerne, la mère d’Arthur. Il y a donc cette question de la violence faite aux femmes ; bien entendu celle faite aux hommes aussi. Celle des hommes est auto perpétrée.
D’ailleurs, Dechtire veut reprendre une présence à la cour et va pousser son fils pour répondre à cet enjeu. Ce fils qui veut aussi, avant tuer le chien du forgeron, se refaire une place. Nous avons l’impression qu’on lui a pourri la vie à ce gamin…
Effectivement, le narrateur le dit d’ailleurs à plusieurs reprises, c’est un enfant qui est la naissance et l’accomplissement des affects de ses parents et représente l’ambition déçue et la rancoeur : ce ne peut être qu’un enfant plein d’ambitions plus ou moins réalisées, ambitieux à tout prix et rancunier. Il va vouloir compenser. Finalement, le personnage du Chien dans mon livre n’est qu’une fuite en avant vers un destin qu’il s’auto-inflige. C’est le parti pris presque non mythologique de la chose. Nous, en tant que lecteur, avec notre vision extérieure et matérialiste, on se dit que bien sûr qu’il aurait pu faire autrement. C’est là où l’étude historique et sociologique est intéressante : il faut tenter de comprendre sans juger. Effectivement, le Chien est détestable mais il a de bonnes raisons d’être détestable qui ne sont pas de bonnes raisons au sens justifications, car pour lui c’est son destin et il doit le faire. Il n’aurait pas pu être autrement et s’il avait réussi à l’être, cela ne se serait pas passé. Il n’aurait pas pu faire autrement parce qu’il avait un poids sociologique trop important sur lui.
Toute la partie éducation est questionnée aussi. Son nom est issu d’une bêtise qu’il a faite. Personne ne lui a dit, et plutôt que d’expliquer ce qu’on attend de lui en termes de posture. On attendait un peu cela de son grand-père Cathbad, druide ou au moins de lui donner la bonne lecture de ce qu’il doit faire. On n’arrête pas de ne pas lui dire et on sent que tous espèrent qu’il devine. Et vient l’incident du chien du forgeron : on aggrave cette situation en le punissant de la sorte, l’obligeant à réagir à cette nouvelle violence.
Tout à fait. C’est toute la question de ces mythologies et qu’on peut retrouver dans plusieurs mythologies : Hercule qui tue le serpent dans son berceau par exemple. Ce sont des personnages faits de violence, et une violence légitime qui sont une expression de la violence qu’on leur fait subir. C’est à dire que s’il n’avait pas été forcé à prendre la place du chien, même si j’invente l’histoire de la course et de la chasse, il ne serait pas devenu ce qu’il est devenu. Dans le texte mythologique, cet événement est présenté comme un exploit que je transforme en punition, même si c’en est aussi une quand même dans le texte d’origine tout en restant un accomplissement de son destin, alors que dans ma vision, c’est une humiliation. De cette humiliation, nous avons un personnage qui retourne en permanence les humiliations : par exemple, quand il est éconduit par Emer, qui ne veut surtout pas de lui et est prête à accepter n’importe qui sauf lui, il retourne cette humiliation. C’est l’image que je reprends dans le roman : c’est une pierre lancée qu’on ne pourra pas arrêter. Tant qu’on n’a pas compris qu’on ne l’arrêtera pas, ce qu’on peut faire c’est éventuellement essayer de la dévier. Tant qu’on la prend frontalement, ça ne marchera pas : la force que nous mettons pour aller contre ce moment, ne fera que blesser les personnes.
On comprend assez vite qu’il a perdu cette forme d’humanité. J’ai eu le sentiment au moment où il devient le chien du forgeron qu’il n’est plus qu’un animal, comme ces mâles dominants qui veulent que dominer.
La question du désir est posée, qui est liée dans notre société à la question de la possession. Ne se peut désirer que ce qu’on ne peut posséder, et ne se peut posséder que ce qu’on ne peut désirer. Du coup les choses sont liées entre les deux et ça donne un être qui cherche à posséder absolument tout. En même temps, dans sa possession, il consomme. Il est extrêmement consommateur et se brûle lui-même, il ne peut que mourir jeune dans cette histoire : il a un retour de karma à la fin, car ses actes finissent par avoir des conséquences malgré la justice du Roi qui laisse couler, et qui n’agit pas vraiment.
Cette virilité conquérante, de possession, ne peut amener qu’à l’absence de désir réel pour moi : c’est justement parce qu’Emer sent ce désir carnassier qu’elle en a peur. C’est un meurtrier, son mariage est un rapt où il tue la moitié du château mais tout le monde laisse couler, parce que c’est quelqu’un d’une lignée importante et il accomplit des exploits. Cette construction de la parole et des histoires, que j’avais touchée avec Bertram le baladin chez Critic, est aussi présente dans Le Chien du Forgeron. Pour moi, le Chien du Forgeron en est une continuation dans certains des thèmes et notamment dans le comment on fabrique l’Histoire et qu’est ce que l’identité d’une figure célèbre. Sans rien dévoiler, dans Bertram le baladin, le baladin n’est pas tout à fait celui qu’il prétend être. C’est le fait qu’on croit qu’il est ce personnage qui lui permet de l’être et de l’incarner. De même pour le Chien, si tout le monde n’avait pas passé sa vie à lui dire qu’il était le Chien du Forgeron, il n’aurait pas été le Chien du Forgeron.
En plus, on a le sentiment que son destin est écrit, il en a deux et choisit celui qui fera de lui le personnage dont on se souviendra, comme si cette virilité devait être écrite dans le temps. Je me suis néanmoins posé une question sur le narrateur, beaucoup plus basique : le narrateur semble s’être pris une rouste et ne salit-il pas volontairement la légende du Chien du Forgeron ?
Le narrateur, Tête Blanche, l’évoque lui-même : vous avez le droit de penser que je cherche à le salir. On a le droit de le penser.
Cette connaissance de ce qu’il a fait est très présente. Quand on parle du héros plusieurs siècles après, qu’on ne se souvienne pas du côté tordu s’entend, mais dans la même temporalité. Les évènements sont quand même très récents au regard de la narration : c’est étonnant que cette absence de mémoire ?
La narration se passe quelques décennies après les évènements. Je pense que si on veut faire l’étude diégétique de cette figure publique du Chien du Forgeron au moment où il existe, il faut dire qu’au moment où on le regarde c’est un héros. Il porte les armes alors que personne ne le faisait et de ce fait tout le monde le fait. C’est une figure positive, au sens où il pose des actes et a une influence concrète sur le monde. Il s’érige / auto-érige en partie, même s’il est aussi érigé par ses origines et son éducation, en modèle. C’est le plus fort, le plus rapide ; tout le monde le dit, tout le monde le sait ; il le voit. Il a ses crises de colère incontrôlable mais on en parle pas, on le laisse sous le tapis, et on mystifie ça comme un don des dieux lui permettant d’être plus fort que les autres. Du coup, sa légende s’auto-construit au fur et à mesure qu’il l’a fait, avec ce personnage du cocher qui me permettait de répondre à cette question et qui va être le primo-narrateur de l’histoire du Chien.
La question que j’avais derrière était concernant la réécriture de l’histoire, sujet à la mode en ce moment, avec des propos qui remettent un peu en question des événements historiques : est-il aussi question de la vigilance à avoir sur les faits versus sur la vision des faits ?
Je ne sais pas. N’étant pas historien, je ne peux pas trop m’exprimer sur le sujet. La question de l’historicité est problématique : il s’agissait de savoir quel degré d’historicité je pouvais amener dans le texte. C’est une réécriture qui se veut réaliste et vraisemblable. Du coup, à quoi ressemble cette histoire dans les conditions matérielles du VIIIè siècle dans une société un peu patriarcale ? Après, il ne s’agit pas d’un roman historique ; la part de “véridiction” dans ce roman n’est pas dans l’historicité. En l’écrivant, je n’ai pas eu la prétention de poser un avertissement quelconque sur ce qu’on raconte. S’il y a peut-être une leçon à tirer, d’ailleurs exprimée à la fin par le narrateur, ce n’est pas moi qui vais vous la donner, à part interroger toujours ce qu’on vous dit, ce qu’on vous présente comme acquis. Il reste pour cela la mémoire pour se souvenir et la main pour transmettre. Ce n’est pas un questionnement sur la réécriture de l’histoire ou sur le révisionnisme.
Parlons de Ru maintenant, paru aux éditions de l’Atalante, doit-on voir aussi une influence musicale ? J’ai pensé à Un chien géant du groupe nantais Ultra-Vomit.
Non, je connais la chanson mais pas du tout.
Du coup, d’où vient cette idée d’une créature géante dans laquelle les gens vivent ?

C’est encore une vieille idée : j’avais vu Pacific Rim de Guillermo Del Toro. C’est une leçon de mise en scène dans la gestion des échelles : j’étais subjugué dès la première bande annonce avec le mouvement du robot qui attrape le paquebot, on a un basculement d’échelle où l’on voit le gigantisme du paquebot et dans le mouvement de caméra, il se retrouve réduit à une taille outil dans la main du robot. J’étais sidéré. C’est un film brillant sur la gestion des échelles. D’ailleurs, il est presque trop brillant : à un moment, il y a une scène qui tient plus de la pose, le moment où le poing du robot s’avance dans l’immeuble, s’arrêtant sur un jouet avec des boules minuscules
Cette gestion des échelles est aussi présente dans Ru.
Il y a une scène dans Pacific Rim où ils ont abattu un monstre, qui reste à terre et plein de personnes arrivent et commencent à la dépiauter et certains rentrent, dont des personnages scientifiques. Je me suis dit qu’il serait marrant d’écrire une histoire avec des gens qui habitent à l’intérieur. C’était en 2014, 2015 et j’avais essayé d’écrire autour de ça mais ça ne marchait pas, ce n’était pas une période où j’écrivais vraiment. Ca m’a travaillé pendant longtemps, j’ai pensé à faire un polar, qui se retrouve dans le personnage d’Alvid qui vient enquêter pour retrouver son mari disparu dans Ru. Je ne saurai pas dire ce qui a déclenché la réécriture de cette histoire, la métaphore du petit qui habite le corps du très grand. C’était la métaphore du corporel, du corps social. Cette division sociale, ségrégation socio-spatiale, qui se passe entre les organes, entre la tête, l’estomac, les intestins. On voit très bien ce que ça veut dire d’habiter le fond d’un organe plein de merde. Il y a un truc qui me permettait d’expliciter certains rapports sociaux et puis aussi d’y toucher : la métaphore du corps géant me facilitait l’entrée dans des questionnements sociaux dans lesquels je ne serai pas arriver paradoxalement, car ça complique la tâche, à entrer dedans. C’est une “faiblesse” de ma part. Ca me permettait cette distance de parler de choses très concrètes et très actuelles, très France 2019.
On a l’impression que la tête est loin du reste, prenant des décisions, notamment autour de l’immigration, de la violence policère : c’est donc un livre pour parler de l’actualité.
Tout à fait. C’est un bouquin rouge, très en colère. C’est un bouquin de colère pure.
Ça me fait penser au débat sur la mutation du travail auquel j’ai assisté. On sent une volonté de partager sur les sujets sociétaux, on te sent très impliqué. Tu nous as donné une pile de lecture impressionnante. Il est important pour toi qu’on se réveille ?
C’est marrant que tu parles de ça, je viens de revoir Matrix et les trois n’ont rien perdu de leur acuité mais c’est un autre débat.
On en revient à cette question de la véridiction : si je suis écrivain, mon travail c’est d’écrire. Si j’écris, c’est que c’est mon moyen d’action privilégié. Et si je veux diriger mes actions vers le bien, vers le vrai, cela veut dire que cela doit se faire par l’écriture. Donc c’est un chemin et c’est très militant, très orienté, et je n’ai pas de problème avec ça. Je prends toutes les accusations de gauchisme qu’on veut, j’en ai rien à foutre, il y a assez de gens de droite partout.
Par contre, sur la question de la conférence sur la mutation du travail, un type est venu me voir en me disant qu’il n’y avait pas de contradiction sur scène : on parle d’idées qui n’ont pas le droit de cité nulle part, on peut bien se payer une heure.
Je ne sais pas si je peux réveiller les gens, je n’ai pas cette prétention là. Je ne suis pas Morpheus. Ce qui est certain, je peux être une courroie de transmission pour faire passer des trucs, pointer du doigts, pour exprimer des choses qui passent à travers moi. Il y a presque un côté usine de transformation. J’ai tendance à avaler beaucoup d’informations rapidement, lire beaucoup de choses. J’ai besoin, pour écrire un bouquin comme Ru, de lire des essais philosophiques et politiques pour réussir à faire tenir le truc. Tout n’est pas dedans, mais pour arriver à le concevoir, j’ai eu besoin de sociologie par exemple. Pour Le Chien du Forgeron, j’ai lu énormément de livres d’histoire, de sociologie, de critique du genre.
En fait, si ce n’est pas écrire pour avoir une action positive et dans le sens “Plus”, ou que j’estime positive en tout cas, sur le monde et sur les lecteurs, pour planter des graines et dire aux lecteurs qui pourraient se sentir seuls qu’ils ne le sont pas, ça n’a pas de sens. Je suis toujours frappé par la question du travail sur le fait qu’il suffit de parler avec n’importe qui en situation d’emploi pour savoir qu’on partage tous les mêmes souffrances. Si j’ai un regret par rapport à Ru, c’est qu’il ne va pas assez loin, il est trop faible pour moi, rétrospectivement.
J’ai essayé d’écrire les trucs les plus terribles que je pouvais concevoir avec cette histoire d’immigration qui est quasi-journalistique pour des raisons professionnelles et au milieu de l’écriture, je lis un article parlant d’une famille en situation de pauvreté abjecte, où je me dis que je n’ai pas assez fort. C’est pour ça que je parlais de Joseph Ponthus : en moitié moins de mots, il arrive à décrire une réalité du monde du travail à côté de laquelle j’étais complètement passée et avec beaucoup plus de force que ce que j’avais pu faire ; c’est une bonne jalousie. Je ne crois pas à la posture de l’écrivain détaché, les littératures d’évasion, sense of wonder. Si j’ai envie de me vider la tête, je branche de la musique, la console, et je vais faire de la randonnée en cueillant des champignons, du cheval dans les collines. La lecture ce n’est pas ça ; c’est rencontrer l’autre, éventuellement se rencontrer soi et une modification de soi-même : les plus beaux livres, c’est ceux qui nous changent un peu. Et si je peux à mon échelle, avec le peu que je fais, changer un tout petit peu les perceptions du lecteur ou la vision qu’il peut avoir de son environnement, je considère que j’ai fait le job. Il m’est arrivé un truc aux Imaginales il y a 15 jours. Il y a deux ans, Malboire était dans le prix des lycéens. J’ai deux gamins de 18 ans qui viennent me voir à la table des dédicaces, parce qu’ils avaient lu le livre, et qui m’ont dit que ça leur avait plu et qu’ils avaient aimé. Ils ont trouvé que le roman était un peu culpabilisant parce qu’en fait s’ils souffrent dans le roman, c’est à cause de nous. Tu dois encaisser le truc et tu te dis que tu as au moins fait ça. C’est le peu que je peux faire en tant qu’écrivain et on sait que certains sont dans des moyens d’actions beaucoup plus concrets, beaucoup plus actifs. Ce que je peux faire en tant qu’écrivain, c’est ça : donner un petit peu des perspectives, ouvrir un peu, transmettre ce que je peux. Une table ronde sur le travail, c’est mon sujet, je ne lis que des choses la-dessus depuis trois ans. C’est juste que les choses sont là et plein de livres qui existent, des penseurs qui font des analyses très fines et c’est juste que c’est une parole étouffée. On en revient à la question de l’éducation et sur Le Chien du Forgeron, c’est un bouquin qui parle de l’éducation des garçons, ce qu’on lui apprend, avec une certaine ferveur dans l’attaque faite à l’éducation des garçons. La lecture et l’écriture de fiction peuvent être non pas seulement un moyen de sortir du monde mais un outil d’éducation politique, en utilisant des gros mots en 2021. J’irai encore plus loin : écrire un bouquin comme Ru m’a profondément changé aussi. Je ne suis plus la même personne depuis que n’ai écrit Ru ; je ne suis plus la même personne depuis que j’ai écrit Le Chien du Forgeron. Du coup, rien que par les lectures pour écrire, j’ai bougé dur parce que tu te prends des trucs de la tronche que tu mets du temps à digérer, complété par les scènes que tu écris, je pense notamment à la scène de tentative de viol dans Le Chien du Forgeron que j’ai éludé car trop dur à écrire. Toute proportion gardée, j’ai lu un bouquin de Johann Chapoutot qui s’appelle la loi du sang, penser et agir en nazi, pour un prochain roman ; 250 pages, extrêmement intéressant mais lourd. Il disait, étudier les fascismes, le IIIème Reich, ça a un coût personnel. Ecrire des romans, écrire de la fiction en voulant avoir une action positive sur le monde et faire exister une possibilité de changement politique par le champ de la littérature, cela à un coût personnel. Ma copine n’en pouvait plus quand j’écrivais Ru et était contente quand j’ai fini parce que j’en avais marre. J’étais tendu, avec dépression post-écriture. Le coût émotionnel n’est pas à négliger mais ça vaut le coup rien que pour les moments où quelqu’un te dit, un gamin de 18 ans par exemple, que ça l’a touché et ça m’a fait comprendre que mes actions ont des conséquences, que ça m’a fait m’interroger sur les conditions matérielles de mon existence et leurs conséquences à moyen et long terme. Rien que ça, ça rachète tout le reste, y compris les heures de trains, le fait de s’arracher les yeux sur un écran et venir faire des tables rondes. Tu te dis : “J’ai fait ça”. Si chacun fait un bout, ça finira par faire quelque chose.