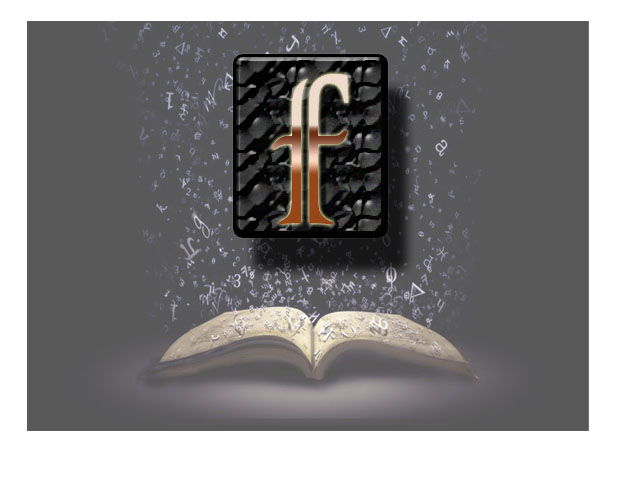Pour ceux qui sont amateurs de la saga Game of Throne, Patrick Marcel n’est pas un inconnu puisqu’il en est le traducteur des derniers volumes de la saga. Mais avant de traduire ce momunent de la fantasy, Patrick avait déjà travaillé sur de grands titres, notamment de Neil Gaiman ou encore de Mary Gentle.
A l’occasion des Utopiales, j’ai pu échangé avec l’homme qui se cache derrière le livre, et notamment autour de son actualité puisqu’il a traduit A la pointe de l’épée d’Ellen Kushner chez ActuSF.
Bonjour Patrick, comment te présenterais-tu ?
Patrick Marcel, traducteur en principe en passe-temps. Comme je dis à chaque fois, c’est un passe-temps qui a horriblement dérapé. En fait, j’ai un métier par ailleurs, une profession régulière. La traduction, c’est parce que je lisais beaucoup en anglais et que, forcément, quand on lit en VO il y a un moment où on se demande comment on traduirait telle phrase. Et puis je connaissais des gens qui ont lancé des revues où se publiaient des nouvelles traduites de l’anglais. J’ai demandé à pouvoir essayer et, de fil en aiguille, voilà où j’en suis actuellement.
Où se situe la complexité dans le métier de traducteur ?
On cherche à faire, comme disait Umberto Eco, un texte qui est presque le même et en même temps pas le même, puisque la langue est différente. Le problème est d’essayer de rendre pour le lecteur de la langue cible les sensations qu’avait celui de la version originale. Ce qui n’est pas possible puisqu’on n’emploie pas les mêmes mots, donc pas les mêmes charges culturelles. Mais on s’y efforce. Il y a souvent des querelles entre ciblistes et sourcistes, suivant qu’on préfère rester au plus près du texte original ou chercher une version qui paraisse le plus possible écrite directement dans la langue cible. Je suis les deux, ça dépend du texte : il y a des passages où on sent bien que ce qu’il faut conserver du texte, c’est la forme ; d’autres où c’est le fond. On opère donc en fonction, tout en essayant à chaque fois de coller autant que possible au texte original. C’est un exercice d’équilibre, de jugement. Je ne pense pas qu’il y ait de recette précise, on travaille au feeling.
Sur le sujet, on voit assez souvent, j’ai fait moi-même ce dérapage, dire d’un livre traduit du style de l’auteur… Ça ne te fait pas grincer des dents ?
Non. Ça me satisfait plutôt puisque, si on parle du style de l’auteur, c’est qu’on n’a pas conscience de la présence d’un traducteur. C’est déjà une bonne chose parce qu’on est dans la lecture, qu’on n’est pas gêné en se disant qu’on n’aurait pas traduit comme cela. Ce qui est toujours embêtant, parce qu’on sort de sa lecture, dans ce cas-là. J’aimerais qu’on dise que le bouquin a été traduit par Untel et qu’apparemment, il a fait un bon boulot mais, franchement, le fait qu’on parle uniquement du style de l’auteur et de son choix de mots, c’est déjà un compliment en creux… En plus, quelque part, c’est vrai puisqu’on cherche à respecter le niveau de langage, le vocabulaire : ça veut dire qu’on a apparemment assez bien retranscrit le style de l’auteur pour que le critique n’ait pas pensé qu’il y avait eu intervention entre les deux.
Tu as traduit, et continues à traduire, un certain nombre de grands noms : Neil Gaiman, Alan Moore, George R.R. Martin, Ellen Kushner… Comment fait-on pour jongler en s’appropriant l’essence de chaque ?
Je ne sais pas bien, je traduis chaque livre comme un cas particulier. Déjà, une fois que j’ai traduit un bouquin, je n’y pense plus. J’ai traduit une série de bouquins, Le Livre de Cendres de Mary Gentle, qui se passait fin Moyen-Âge, début Renaissance, et racontait les aventures d’une capitaine de mercenaires. C’était extrêmement précis comme vocabulaire : à la fin de la traduction, j’étais capable de monter / démonter une armure pièce par pièce, en anglais comme en français ! Maintenant, j’ai complètement oublié. Parce qu’on ne peut pas tout garder. Mais ça exige une tournure d’esprit particulière, qu’on garde durant toute la traduction, pour l’abandonner ensuite, en passant à un autre roman. C’est de l’immersion.

Ça dépend aussi des méthodes. Je suis un laborieux, c’est-à-dire que je fais un premier dégrossissage quand je traduis. Je prends le bouquin, très souvent je ne l’ai pas lu, je sais que c’est Neil Gaiman, par exemple, je suis en confiance et ça m’intéresse. Je prends le livre, je le traduis directement au fil du clavier, et ça me donne un bloc de texte. On me dit : et si tu t’aperçois que page 350 que le personnage était un homme alors que tout laissait penser que c’était une femme au début ? Ce n’est pas grave puisqu’après je reviens dessus. Trois, quatre, cinq, six fois. Le pire que c’est Good Omens (NdW : De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman), parce qu’avec les relectures et les révisions, j’ai dû le lire dix-sept fois. Je commence un peu à le connaitre par cœur. Ce sont des couches de corrections qui se rajoutent, que j’affine encore et encore jusqu’à ce que je sois satisfait du résultat — et que la date de remise arrive. C’est ma méthode, je travaille comme ça. Dans le cas de Neil Gaiman, dont j’ai traduit plusieurs bouquins, je le connaissais personnellement avant de le traduire : ça aide, j’entends sa voix, ça me guide un peu.
Pour Le Trône de fer, l’histoire est particulière, n’étant pas le premier traducteur, ce n’est pas compliqué de reprendre après un collègue, ici Jean Sola ?
C’est embêtant parce qu’on donne une phrase, « la petite maison est rouge », à douze traducteurs et, sans dire qu’ils donneront douze versions différentes, il y en aura au moins quatre ou cinq, parce que nous ne percevons pas les choses de la même façon. En plus, il y a des questions de contexte, on pense que dans une phrase, on doit mettre telle ou telle chose en avant. C’est pour ça que, pour Shakespeare par exemple, on le retraduit quasiment à chaque fois qu’on monte une de ses pièces en français : parce qu’en lisant Shakespeare, tel ou tel metteur en scène y a discerné tel ou tel thème et, lorsqu’il relit les traductions précédentes, ce thème n’a pas été assez mis en valeur à son goût, alors il refait une traduction selon cette orientation. Ça se discute, c’est bien ou pas, mais bref, difficile de trouver une unité de traduction.
Forcément, en reprenant la traduction de quelqu’un d’autre après quatre volumes, on doit rester dans la trajectoire. Il est notamment hors de question de changer les noms parce qu’ils ne plaisent pas. Le lecteur serait perdu. Je suis obligé de les garder, ce qui est parfois un peu gênant. J’avoue que certains termes m’agacent et que je les ai légèrement changés. Au début du cinquième volume, on parle toujours des loups-garous des Stark, mais, comme ce terme ne colle pas bien selon moi, on parle petit à petit de loups, simplement, et puis, au bout d’un moment, de loups géants. Et, à part pour les armes des Stark — puisque le loup-garou est l’emblème héraldique et donc le terme consacré —, si ça tient à moi, on ne reverra plus le nom « loup-garou » dans le reste de la saga. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. J’essaie d’opérer graduellement.
Comme pour le style. Jean Sola avait tendance à employer un style très médiévalisé alors que George R. R. Martin a un style très simple pour montrer le côté présent des personnages. D’ailleurs, il fait d’autres choses, appeler les personnages par des diminutifs. Jean Sola n’avait pas repris Dany pour Daenerys, je le suis assez sur ce sujet parce que « Dany » sonne un peu trop américain, quand même. Mais en même temps, c’est toute la démarche de Martin : dans ce cadre très pseudo-médiéval, aux coutumes très archaïques, on voit agir des personnages actuels, l’éternel humain. C’est ce qui est important dans la saga : ce sont des personnages semblables à nous, y compris dans leurs réactions, qui ont d’autres mœurs, coutumes, pratiques mais s’expriment de façon courante, pour qu’on les comprenne bien, qu’on voie en quoi ils nous sont proches, en quoi ils sont nous… Peut-être juste un peu plus assassins et cruels que la moyenne.
Pour les noms, je fais avec. On ne peut pas changer ceux qu’on a employés durant quatre volumes, même si certains noms non traduits me gênent. Ainsi, le fait que le seigneur de la Treille, réputé pour ses vignobles et ses vins, s’appelle en français Lord Redwyne, ça perturbe, j’avoue. On m’a répliqué qu’on ne pouvait pas traduire par « Lord Vinrouge ». Non, pas ainsi, mais il suffit de chercher un nom plus explicite qui sonne bien.
Par rapport à Game of Thrones toujours, la dernière saison télévisuelle a fait couler beaucoup d’encre, peut-on compter sur toi si George R. R. Martin se fourvoie en faisant la même fin ?
Je ne m’inquiète pas trop pour ça. Le problème de la série, à mon avis, ne vient pas vraiment de ce qui se passe, même si certain ont protesté que, dès qu’une femme acquiert du pouvoir, on la fait basculer dans la folie : Daenerys pour moi n’est pas folle. L’arc des personnages risque d’être assez proche dans les romans, à moins que George R. R. Martin ne décide de l’infléchir après avoir vu la série. Je ne sais pas. Je pense qu’au départ, c’était parti pour cette fin. Simplement, le problème, je suppose, est que les deux responsables étaient très pressés de partir signer leur trilogie Star Wars. HBO leur a proposé de réaliser une saison complète et ils ont répondu que huit épisodes suffiraient. Non, ça n’a pas suffi et beaucoup de choses passent mal, à mon avis, parce qu’elles sont amenées de manière bâclée. On sentait déjà ça depuis une ou deux saisons, avec ces armées qui passaient d’un bout à l’autre d’un continent en cinq minutes.
Le sujet qui m’a bien gêné c’est Bran en mode avion face au roi de la Nuit…
En plus, il ne sert pas à grand-chose, Bran. Il donne des conseils, mais nous n’avons pas l’impression d’un potentiel réalisé. À part au moment où il explique à John Snow qu’il est l’héritier des Targaryen… C’est maigre. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la série. C’est d’autant plus agaçant que les personnages étaient bien écrits, les scènes restaient fortes, sauf la séquence finale de « On va inventer la démocratie ». Mais ça fait deux saisons que Tyrion, le personnage le plus intelligent de la série, est devenu un parfait idiot qui multiplie les loupés. C’est frustrant.
Ou Varys qui tombe dans un piège stupide…
Oui aussi. C’est vraiment une fin bâclée et, en même temps, les scènes elles-mêmes restaient belles, les batailles étaient superbes, comme la bataille de Winterfell de nuit dans laquelle nous ne voyons presque rien. « C’est dégoûtant, on ne voit presque rien ! » Non, c’est un choix : ils sont parfaitement capables de tourner des batailles de nuit, où on voit clairement. S’ils font ça, c’est pour retranscrire la bataille, sa confusion. C’est une très bonne idée visuelle. Mais ensuite, effectivement, beaucoup de choses sont bâclées car pas pensées correctement. Il faut arriver très vite au bout, et on n’a plus que deux épisodes… C’est comme ça.
Le deuxième titre dont je voulais parler c’est À la pointe de l’épée d’Ellen Kushner… Comment on travaille avec Ellen ?
Bien, c’est un plaisir. C’est une autrice dont je connaissais un roman avant de la traduire. J’avais lu Thomas le Rimeur, un bouquin fabuleux, un de mes livres de fantasy préféré : l’histoire de Thomas, enlevé par la Reine des Fées, qui passe sept ans dans le royaume des Fées mais doit rester silencieux, ce qui gênant pour un barde. Quand il revient, il est profondément changé par cette expérience. On suit toute l’histoire racontée par les gens autour de lui et c’est vraiment formidable.
Je ne l’avais pas lu À la pointe… quand on m’a demandé de le traduire, mais, à cause de Thomas le rimeur, j’ai dit oui. Le livre n’a pas rencontré son public la première fois. Il était pourtant sorti dans une belle collection, Interstices chez Calmann-Lévy, de mémoire. Il y avait sa place, car c’est un livre délicat à définir : j’ai vu qu’on le définissait en le comparant aux Trois Mousquetaires, mais ce ne sont pas des cavalcades effrénées pour rapporter les ferrets de la Reine. Il y a quelques duels mais le livre parle surtout de rapports complexes entre personnages, de conspirations, de manigances, de choses comme ça. C’est une tragédie de mœurs, comme il y a des comédies de mœurs qui reposent sur la conduite des personnages.

Là, ça se passe dans un monde par ailleurs très indéfini. Il y a la Ville, qui n’est jamais nommée, un quartier qui, lui, est nommé : Riverside, le nom d’un quartier de New York où a vécu Ellen, et que j’ai traduit par les Bord-d’eaux puisque j’habite Bordeaux et que ça collait. Les riches habitent au sommet d’une grande colline, la population vit à mi-hauteur et la racaille en bas dans un quartier mal famé et abandonné depuis longtemps par les riches. Les riches ont besoin de la racaille parce qu’ils règlent leurs questions d’honneur en engageant des spadassins et Richard Saint-Vière en est le plus grand. Il est très doué et combat pour vider des querelles. Souvent des querelles d’honneur ou supposées telles, mais ce sont aussi parfois des assassinats politiques.
Tout le bouquin repose là-dessus et, quand on sait à quoi s’attendre, c’est superbe. Par contre, si on arrive en pensant trouver les Trois Mousquetaires, on risque d’être décontenancé, parce que ce n’est pas ça. C’est une fantasy spéciale, car elle ne contient pas d’élément fantastique. En fait, il y a dans le cycle une seule nouvelle fantastique et… elle n’appartient pas au cycle : elle est reprise dans le recueil, à la fin, en complément, parce que ce sont les mêmes personnages. C’est la première qu’ait écrite Ellen et elle comporte un événement qui semble surnaturel. Mais sinon, c’est une série historique qui se déroule… ailleurs. Et c’est très bien parce que les personnages sont intéressants : Richard Saint-Vière, qui a pour amant Alec qui est insupportable, haïssable, un capricieux qui fait des drames, a des foucades, est suicidaire, drogué, qui a tous les défauts possibles et qui finit par être attachant — c’est ça le pire ! Il y a la duchesse de Trémontaine qui tire nombre de ficelles sans en avoir l’air. Il y a un jeune homme qui se retrouve embrouillé dans une méprise avec un autre noble qui veut lui faire payer sa déconvenue. Ça lance tout un écheveau de querelles. C’est extrêmement bien et souvent très amusant.
En plus, ce recueil rassemble tout le cycle. C’est-à-dire qu’Ellen a écrit par ailleurs des nouvelles qui se situent avant ou après le roman ; cela apporte du contexte. Elle a aussi ajouté des lettres qui sont inédites même en anglais, écrites spécialement pour cette édition française et non seulement c’est bien, car ça fait jonction entre les différents textes et développe un peu plus le personnage assez fascinant de la mère de Richard, mais en plus c’est joliment vicieux : la dernière lettre fait basculer le cycle dans l’uchronie, car elle est datée de nos jours, mais un « de nos jours » qui serait la conséquence de cet autre univers XVIIè ou XVIIIè siècle. Ça a un côté vertigineux.
Ce sont des textes superbes. Une nouvelle que j’avais déjà traduite, Un jeune homme de mauvaise vie, a déjà reçu un prix en France. Elle raconte la jeunesse de Richard Saint-Vière et a une ambiance à la fois fraîche et érotique, très érotique mais légèrement perverse, c’est un mélange très curieux, très fort. J’aime vraiment beaucoup ce qu’Ellen écrit. Il existe en anglais d’autres romans situés à d’autres périodes. J’espère bien que ça va marcher, pour que nous puissions faire des romans suivants du cycle.
Tu as eu deux prix Jacques Chambon de la traduction : ça fait quoi ?
Ça fait plaisir. C’est souvent pour des bouquins un peu acrobatiques. Le côté casse-tête attire l’attention. Il y a eu des bouquins où j’étais parfois plus content de ma traduction : j’ai traduit un Bradbury dont j’étais très fier car, quand l’ai remis à Gilles Dumay, il m’a dit qu’il n’y avait pas un mot à changer. C’est la première — la seule ! — fois que cela m’est arrivé : il y a toujours de petits défauts à corriger. Là, rien. Il faut dire que c’est Ray Bradbury et que j’avais bien bossé. C’était un livre assez mince, ça aidait aussi.
J’ai eu le Chambon la première fois pour Le Livre de Cendres où, effectivement, j’ai beaucoup fouillé le vocabulaire médiéval parce que Mary Gentle est adepte de reconstitution historique : le week-end apparemment, elle se détend en livrant des duels en armure. Donc, elle est d’une redoutable précision dans ses termes. Autant George R. R. Martin reste dans le flou — les personnages prennent une épée, de temps en temps c’est une épée longue, mais on ne précise pas si c’est une flamberge, un espadon : c’est une épée —, autant, chez Mary Gentle, c’est vraiment telle épée précise, tel poids, tel machin. Il ne faut pas confondre un espadon et une colichemarde ! De même, j’ai reçu le prix pour Les Chroniques du Radch. Il faut dire que là encore, c’était un peu acrobatique : j’ai failli devenir fou en traduisant le premier tome, parce que désigner tous les personnages par le féminin, passe encore, mais il fallait en même temps conserver au masculin les titres tels que le prêtre, le professeur, le consul, et non donc dire la consul, la prêtre, la professeur. Quand on a l’habitude des règles de grammaire courantes, c’est toujours difficile en relisant de ne pas se laisser porter par l’élan des habitudes, de respecter ces règles artificielles qu’on doit adapter au français. J’ai failli devenir fou ; le directeur de collection, pas loin non plus, et la correctrice, on a eu du mal avec. Il y a par conséquent un petit peu côté récompense de la performance sportive. Mais ça fait plaisir, évidemment.