Depuis plusieurs années Anouck Faure s’est fait connaître autant pour ses illustrations, que l’on retrouve chez plusieurs éditeurs que pour ses écrits, avec déjà deux romans aux éditions Argyll, La Cité diaphane et Aatéa, récipiendaire du Prix Christine Rabin de la 25ème heure du livre. Elle est aussi l’illustratrice attitrée de la collection RéciFs. Nous avons pu échanger avec Anouck durant les Utopiales
Vous retrouverez ici la retranscription de l’interview
Bonjour Anouk.
Bonjour.
Merci d’avoir accepté cette interview aux Utopiales.
Merci de me recevoir.
Première question: est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, je suis autrice, illustratrice, artiste plasticienne originaire de Nouvelle-Calédonie. J’ai d’abord commencé à travailler dans le domaine des littératures de l’imaginaire en tant qu’illustratrice en faisant des découvertures pour La Volte, pour Albert Michel, pour Folio SF, en commençant comme ça à illustrer des œuvres dans cette littérature que j’aime lire depuis très longtemps. Et en parallèle, j’écrivais aussi depuis longtemps. Et puis, j’ai publié mon premier roman, La Cité diaphane, en 2023 aux éditions Argyll. Et maintenant, je continue à travailler aussi bien en tant qu’illustratrice qu’autrice, avec mon deuxième roman à Aatea qui est paru en début d’année, en janvier.
Et du coup, qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans la littérature d’imaginaire ?
C’est une grande question. C’est vrai que c’est vraiment la littérature qui m’accompagne depuis l’enfance. Mon père lisait énormément de fantaisie, de science-fiction, donc j’ai commencé par puiser dans ses livres. Je pense que ce qui va tout de suite plu, c’est le pouvoir d’évocation, aussi ce qu’on appelle le sense of wonder, cette espèce de vertige d’imaginer des possibles, d’imaginer toute une diversité de de regards, de possibilités. J’ai trouvé que c’était aussi une façon vraiment très riche et fascinante de parler aussi de notre monde et de toutes les choses qui le composent avec un petit pas de côté.
Et donc tes deux romans, La Cité diaphane et Aatea, sont publiés chez Argyll. Comment s’est passée cette prise de contact avec Argyll et comment es-tu passée d’une reconnaissance d’illustratrice à une reconnaissance aussi d’autrice, on peut en imaginer ?
Sur un chemin assez classique. J’ai écrit le manuscrit de La Cité diaphane et j’avais repéré un peu tous les éditeurs qui me plaisaient, qui m’intéressaient, dont je lisais les œuvres. Et Argyll était alors une toute jeune maison d’édition puisqu’elles se sont créées en 2020, je crois. Et… 2021, pardon. Et donc, je suivais aussi leur démarche éthique qu’ils essaient de mettre en place par rapport au contrat d’édition, par rapport à la pression dans le monde du livre. Donc, je leur ai envoyé mon manuscrit par mail comme tout jeune auteur pas encore dans le milieu. Ils ont accepté mon manuscrit très vite et ça a été le début d’une belle collaboration. Il y a eu tout de suite une complicité qui s’est mise en place avec Simon Pinel, Xavier Dollo, qui sont les deux éditeurs fondateurs, et ensuite Florence Bouriot, qui les a rejoints à l’équipe éditoriale. On a commencé à travailler ensemble plus largement aussi sur la collection RéciFs, qui est une collection de novellas d’imaginaire dont je réalise toutes les couvertures. Maintenant, c’est vraiment un échange de travail assez régulier. Il m’accompagne dans mon processus d’écriture. On travaille ensemble sur cette collection qui m’est très chère aussi, avec tous les textes et toutes les nouvelles voix qu’elle fait découvrir aussi.
On reparlera un peu plus tard de la collection RéciFs, parce que c’est vrai que la démarche illustration graphique est très intéressante. En tant que jeune autrice, au moment où on se retrouve avec son roman dans les mains, on se dit quoi ?
Forcément, c’est hyper émouvant. Sachant que c’est vrai que j’ai un peu sauté certaines étapes… Mon premier livre n’est pas mon premier roman, c’est-à-dire que j’ai d’abord publié un album Jeunesse aux Éditions Alice Jeunesse et deux livres d’art et de poésie aux Éditions Aperion qui étaient plutôt beaucoup de dessins, un tout petit peu deux textes poétiques autour de l’Océanie, de l’insularité. Finalement, La Cité diaphane, c’était en réalité mon quatrième livre. Mais malgré tout, le temps de travail, le temps d’investissement émotionnel sur un roman est aussi beaucoup plus énorme. J’avais aussi illustré La Cité diaphane, donc il y avait eu tout ce temps de travail en plus, tous ces échanges. C’était effectivement hyper émouvant de commencer aussi à entrer dans ce monde des salons, des échanges avec les lecteurs qui étaient beaucoup plus soutenu.
Là, on arrive à Aatea, qui est sortie récemment. La dimension maritime, elle est très présente. J’ai trouvé un renversement du rapport à la nature. C’est-à-dire que là, l’homme et la femme, d’ailleurs, sont rattachés au travers d’un filament à l’île. Est-ce que c’est un contrepied, finalement, à notre vision aujourd’hui de la nature soumise à l’humanité ?
Peut-être un contrepied involontaire, on va dire. C’est-à-dire qu’effectivement, dans nos sociétés occidentales, très technologiques. On a sans doute, je pense, l’impression de contrôler la nature, en tout cas dans des environnements, la plupart de nos vies, qui sont très contrôlées, très surveillées, très sécurisées. Et ayant grandi en Océanie, en Nouvelle-Calédonie, j’avais toujours été confrontée aussi à la mer, à des espaces de nature encore intouchés, sauvages. Et pour moi, c’était vraiment cette dimension extrêmement forte de la nature sauvage, de la nature brute, que je voulais restituer et qui me touche aussi. Donc c’était plus redonner la place centrale à cette forme de la nature toute puissante que je trouve extrêmement intéressante, parce que finalement, l’impression de sécurité qu’on peut avoir par rapport à la nature est aussi toujours un peu factice. Finalement, quand il y a des catastrophes naturelles, on se rend bien compte. Là, je voulais vraiment présenter un univers où il n’y a même pas cet aspect de croyance qu’on croit la nature. C’est la nature qui est complètement supériorité.
On suit le personnage d’Aatéa. Ce personnage, il montre une société à deux vitesses, ceux qui ont le filament et ceux qui ne l’ont pas. Au travers de son histoire, c’est aussi tout un vocabulaire que tu as construit. On retrouve les termes maritimes et je vois dans tes propos l’attachement. Comment on construit cet univers en même temps très novateur, ce qui m’a beaucoup surpris par les éléments, et tout en restant cohérent pour ne pas perdre le lecteur ?
Oui, il présente même une société à plusieurs vitesses puisqu’on est même dans un système de castes où de toute façon, il y a vraiment des niveaux sociaux très différents selon les castes auxquelles on appartient. Pour moi, c’était vraiment l’impression de me fondre dans un univers qui m’était très familier parce que finalement, je retranscris dans cet univers, évidemment de façon exacerbée, démesurée, des choses qui font partie de mon paysage intérieur depuis l’enfance. Cette nature avec la présence des racines, de la roche, de l’océan. C’était vraiment finalement créer en plusieurs dimensions et donner vie à un récit dans ce monde que j’explorais déjà beaucoup à travers la gravure et le dessin en tant qu’artiste plasticienne. Et après, ça a été un enrichissement assez naturel, finalement, la navigation, ça m’a quand même demandé beaucoup de recherches parce qu’il y avait beaucoup de scènes de navigation à voile pour avoir tous ces termes techniques. Et quand j’écris, je me laisse beaucoup porter par le… Je ne sais pas, le sorte de rythme naturel qu’il y a dans le texte, dans le monde. Tout est un peu autogénéré. Le monde génère le style et du coup, le style génère le vocabulaire qui l’accompagne. Les mots se sont créés naturellement pour décrire l’onception qui est cette espèce de sens supplémentaire des navigateurs qui vont ressentir les mouvements des courants, des vents, des marais pour pouvoir se déplacer dans ce monde. Et puis tous les rapports au vent, à l’impermanence des choses, vu que c’est un monde qui est très instable.
Oui, et d’ailleurs c’est ce qui sauve un peu Aatea, ce don qu’il a de percevoir. Et quand tu parlais de castes, ce n’est pas le caste au sens réellement héréditaire du terme, puisque finalement, Aatea était fils de reine, je crois que c’est une reine, et que du coup, il perd ce statut un peu privilégié par l’absence de lien. Donc, on est plus sur de l’inné que de l’acquis…
Oui, les deux cohabitent dans la société. Effectivement, il y a chez les navigateurs, qui sont donc toutes les personnes qui sont pourvues de ce don d’onception, de sentir les courants, deux castes, une caste dominante, une caste servante. Et c’est un peu différents critères politiques qui vont répartir les individus en fonction de castes. Il y a aussi des castes de nobles, des castes d’artisans. Tout ça appartient au domaine de l’hérédité. Il y a le cas spécifique d’Aatea, qui n’a pas pu recevoir le filament qui est cet organe qui permet de créer une relation de symbiose avec les îles vivantes sur lesquelles son peuple vit et de survivre aux toxines mortelles de ces îles. De ce double fait, il se retrouve marginalisé en situation de paria et tenu à l’écart des îles, à vivre sur les ports, les ponts flottants. Il y a une sorte de double dégradation de statut.
Qui perd en plus en étant responsable du bateau qui se fait attaquer, ne réussissant pas à le sauver.
Oui, c’est la situation un peu de déclenchement du récit où il y a un problème sur un bateau dont il est le navigateur et il se retrouve finalement jugé responsable de ce qui s’est passé et il perd les derniers éléments de statut auxquels il pouvait se rapprocher, notamment l’autorisation de naviguer en mer qui était un peu son seul espace de liberté. C’est donc un peu le point d’entrée dans le récit.
Tu as aussi réalisé les illustrations, c’est-à-dire que tu es à tous les niveaux du récit. Ce n’est pas compliqué d’illustrer son propre récit ?
Je trouve ça assez facile. Après, c’est plus quand j’écris, j’ai tellement d’images, de choses qui me viennent en tête. Il faut faire un énorme tri, finalement. Ce qui m’aide là-dedans, c’est de choisir une intention. Quand j’avais illustré La Cité diaphane, mon premier roman, l’intention, c’était de pousser la dimension roman gothique, roman XIXᵉ, romantisme noir qui pouvait y avoir avec des illustrations finalement très cadrées, très architecturales, avec un côté Gustave Doré très présent. Pour Aatea, j’ai voulu utiliser l’illustration pour appuyer ce rapport très charnel, très organique entre l’humain et la nature, avec des illustrations qui fusionnent un peu les textures de la roche, de l’océan, avec les figures des personnages, qui sont plus des représentations symboliques que vraiment des scènes du récit.
Tu as été au Mans il y a quelques semaines pour le Festival Faites Lire où on t’a remis le prix Christine Rabin de la 25ème heure. Ça fait quoi de recevoir un prix pour son deuxième roman ?
Ça m’a beaucoup touché et surtout de de savoir que mon roman a marqué le jury au point de me remettre ce prix, d’intervenir dans ce salon, de rencontrer aussi d’autres publics et globalement de voir aussi tout l’engouement que je peux constater avec beaucoup de libraires aussi qui le soutiennent, qui l’accompagnent. Ça fait vraiment chaud au cœur quand on a mis beaucoup de soi dans l’écriture d’un roman, qu’on y a consacré beaucoup de temps, de voir ensuite toutes ces personnes qui s’en emparent, qui contribuent à le porter.
Maintenant, on va passer un peu sur ton métier d’illustratrice. Tu as travaillé déjà avec pas mal d’éditeurs, Argyll évidemment, et on parlera de la collection de Novella RéciFs, Denoël, Albin Michel. J’ai noté aussi Callidor et J’avais une question par rapport à Callidor, parce que c’est une maison d’édition avec une charte graphique qui est quand même très marquée. Ce n’est pas trop compliqué de s’inscrire dans une charte graphique déjà imposée ?
C’est intéressant, c’est un peu un challenge. Sachant qu’on a commencé à travailler ensemble depuis assez longtemps avec Thierry Fraisse, le fondateur de Callidor, et à une époque où il n’avait pas encore une charte graphique aussi marquée, qui n’est d’ailleurs pas encore sortie. Les choses se passent parfois un peu dans le désordre, mais ensuite, on a fait deux autres livres ensemble, qui est le Fort intérieur et Les trois Malla-Moulgars qui sont sortis dans sa nouvelle charte graphique, effectivement, avec ce fond noir, le travail des dorures. C’était effectivement un peu un challenge pour moi parce que je n’avais pas du tout l’habitude de travailler avec le de la dorure à chaud et cette contrainte du noir, du blanc, très tranché. Mais c’était vraiment intéressant. Et en plus, c’est toujours un plaisir de travailler avec Thierry parce qu’il a vraiment une vraie vision artistique et un regard très précis sur le travail de composition, sur la façon dont texte et image interagissent. Donc c’est vraiment très enrichissant, je trouve, en tant qu’illustrateur d’interagir avec lui là-dessus.
Oui, les livres de Calidor sont d’une très grande qualité.
Chaque fois qu’il en sort un nouveau, il est toujours plus beau que celui d’avant. Donc C’est toujours une admiration permanente pour son travail aussi.
Tu es aussi l’illustratrice attitrée de la collection RéciFs. Que représente RéciFspour toi ?
Pour moi, c’est un peu ma collection parce que je fais aussi partie du comité de sélection des textes. Donc maintenant, je lis les textes bien en amont. J’en défends certains becs et ongles quand je sens des textes qui me paraissent vraiment important de publier. C’est des voix du monde entier qui portent toute une diversité de regards qui reprennent cette idée, ce que je disais de l’imaginaire qui permet des regards différents sur le monde, sur différentes facettes du monde. C’est six à sept titres par an, RéciFs. C’est à la fois tout l’enjeu pour moi de construire un imaginaire visuel qui soit cohérent où dès qu’on voit un seul titre, on reconnaît immédiatement que c’est un RéciFs et en même temps, on reconnaît que c’est ce RéciFs. C’est-à-dire qu’il n’y a pas non plus une trop grande uniformité et de confusion qui pourrait se créer entre les titres avec les choix de couleurs. Moi qui travaille beaucoup en noir et blanc à l’origine, qui suis plutôt dessinatrice, ça a aussi été l’enjeu d’apporter une dimension colorée particulièrement pour cette collection. J’ai toujours beaucoup de plaisir à lire ces textes, les accompagner et les illustrer.
Et ce n’est pas la seule collection de Novellas où finalement, il y a un marqueur illustration… Je pense à la collection Une heure lumière du Bélial avec Aurélien Police.
Tout à fait.
Est-ce que le phénomène collection au sens collectionneur est aussi un élément qui fait qu’en tant qu’illustratrice, le travail est intéressant d’inciter simplement par le fait d’avoir l’ensemble de la collection, la mise en avant de cette approche ?
Je n’avais pas forcément conscience à quel point ça jouait. C’est vrai que moi, je suis lectrice d’Une heure lumière et d’autres novellas depuis longtemps. J’aime énormément le travail d’Aurélien Police que je trouve très beau, mais j’ai quand même une dimension un peu picoreuse. C’est-à-dire que je ne vais pas acheter toute la collection, je vais vraiment repérer les textes dans la collection qui vont me plaire, qui vont avoir des chances de me parler en en discutant aussi avec les éditeurs, avec les libraires. Et j’ai remarqué effectivement en échangeant qu’il y a beaucoup de gens qui, pour cet effet collection, vont vouloir découvrir tous les titres et je trouve ça hyper enrichissant. Et pour moi, il y a le plaisir aussi de voir que les gens aiment les couvertures, qu’ils les reconnaissent, qu’ils y adhèrent et de pouvoir construire ce propos illustré sur la durée.
C’est mon cas. Je vais aller chercher les deux derniers qui sont en avant-première. Sans savoir les titres, même si Simon me les a dit.
Ça, c’est parce que ça crée aussi une relation de confiance. On les reconnaît tout de suite, on a aimé les premiers, on sait que c’est des textes qui ont été sélectionnés avec soin et du coup, il y a une confiance qui s’instaure. Et ce qui est génial avec les novellas, c’est que ce sont des textes qui sont toujours relativement courts, relativement rapides à lire et on peut découvrir des choses qui vont nous sortir de notre zone de confort. Et en même temps, ça ne va pas être un engagement aussi long que sur un roman de 900 pages. Donc, il y a ce plaisir de sortir un peu de ses habitudes et de découvrir d’autres voies, d’autres regards.
Et du coup, parce que je découvre là que tu faisais partie du comité de sélection des textes aussi, donc je ne peux pas m’empêcher de te poser la question. Katia, qui reçoit hier le prix Verlanger pour Re:Start, ça fait quoi quand on appartient au comité de lecture ?
Pour le coup, j’ai rejoint le comité après que le texte ait été choisi, mais je l’ai lu bien en avant pour faire la couverture et c’est un texte que j’ai tout de suite, dès que je l’ai lu, trouvé très puissant. Je me suis dit : c’est vraiment un texte qui a le potentiel pour beaucoup marquer les lecteurs et puis pour toucher plein de gens. Ça a été un gros travail sur la couverture aussi pour positionner le texte qui peut être par certains aspects aussi assez dur, assez violent, et qu’il fallait rendre toute la dimension du texte et en même temps pas faire une couverture qui soit rebutante, qui faille donner envie de plonger dans cet univers de Katia. Je suis vraiment très heureuse pour elle et très fière qu’elle ait eu ce prix Julia Verlanger. Je lui souhaite encore plein de belles choses pour la suite et pour des prochains textes.
Du coup, Avant de parler de ta présence aux Utopiales, une avant-dernière question, en quelque sorte, tu as un prochain roman en tête ?
Avec Aatéa, je me suis vraiment laissée le temps de respirer après l’écriture. J’ai eu quand même beaucoup de salons, j’ai fait beaucoup de promotions et surtout cette année, j’ai vraiment consacré beaucoup de temps à l’illustration. J’ai plein de projets qui vont paraître dans les mois à venir. Et donc, pour l’instant, je me laisse le temps. J’ai plein de projets qui me font envie, entre lesquels je tâtonne un peu. Je teste la température de l’eau, mais je n’ai pas encore vraiment lancé quelque chose de précis. Je me laisse le temps de trouver aussi ce qui résonne de façon juste.
Et du coup, tu parles de tourner, de tous ceux des utopiales comme point d’orgue pour aujourd’hui. Quelle est l’importance pour toi des salons en tant qu’ autrice et illustratrice ?
C’est extrêmement important. Évidemment, c’est aussi les moments où on se confronte directement à la réalité que des gens lisent ce qu’on écrit et en parle et que ça les marque et que ça les touche. C’est toujours des moments d’échange qui sont très riches. C’est à la fois des moments toujours très intenses, assez intense, assez épuisant parce qu’on court partout, on a plein de rencontres, plein d’échanges, on voit beaucoup de gens. Et en même temps, pour moi, c’est vraiment une grande reconnaissance de pouvoir recevoir les retours de toutes ces personnes et puis ces échanges avec aussi bien les libraires, les éditeurs des autres maisons, les blogueurs, toutes les personnes qui font vivre cette communauté de l’imaginaire.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour ton temps.
Merci beaucoup à toi
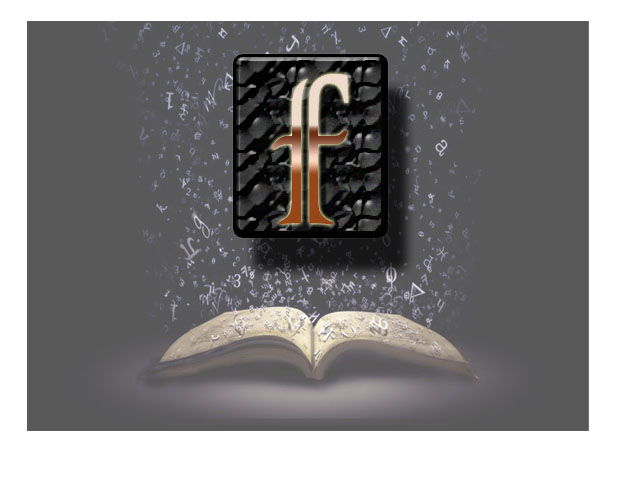

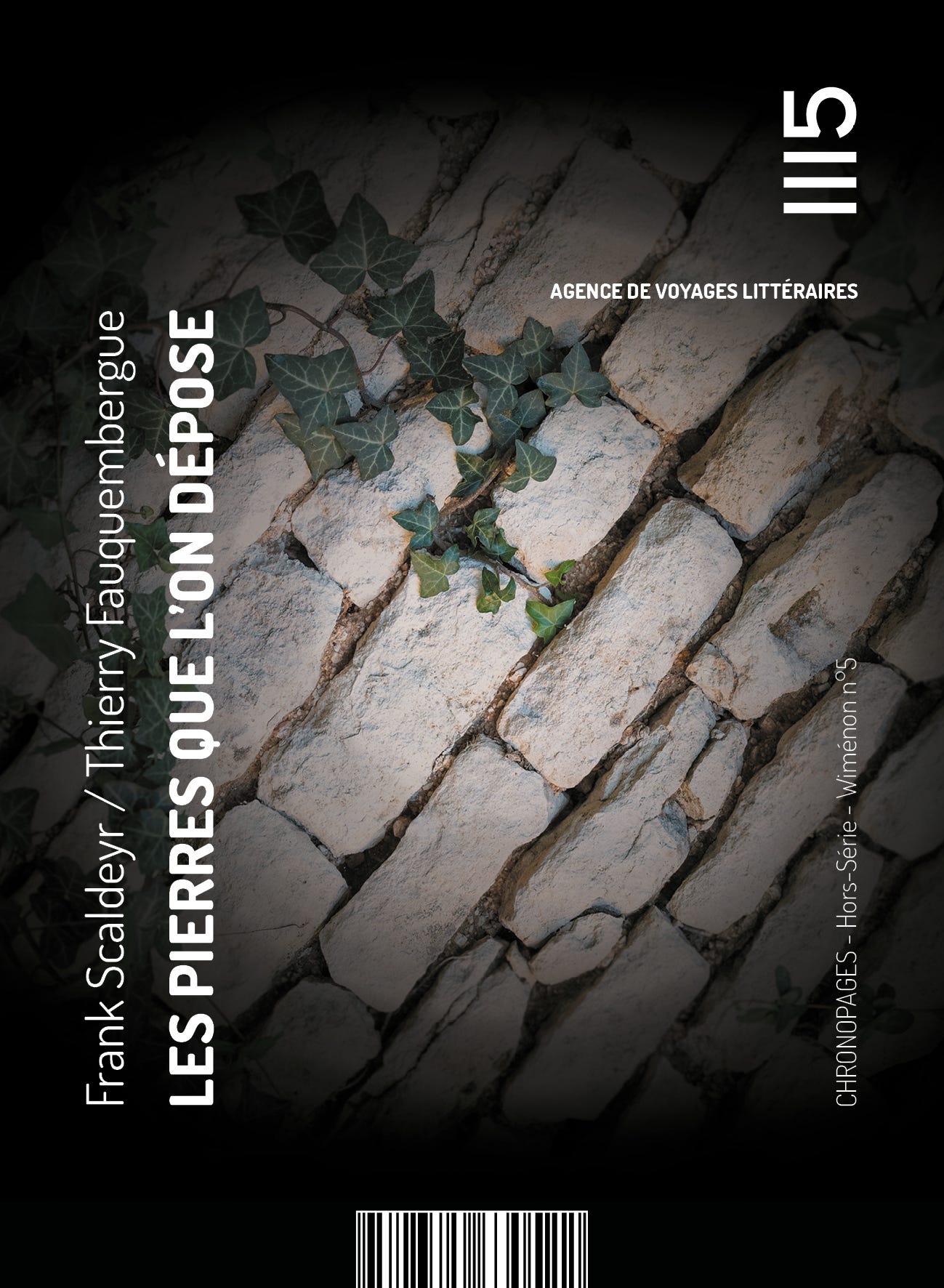

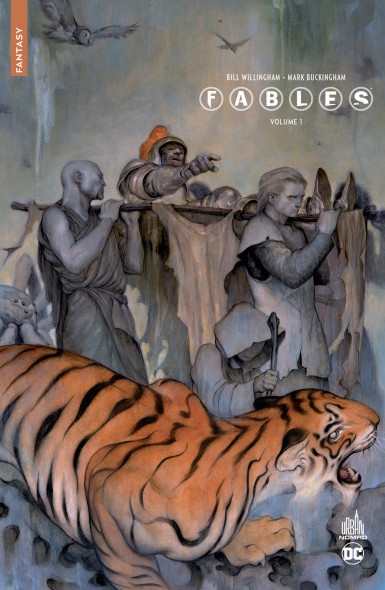







Laisser un commentaire