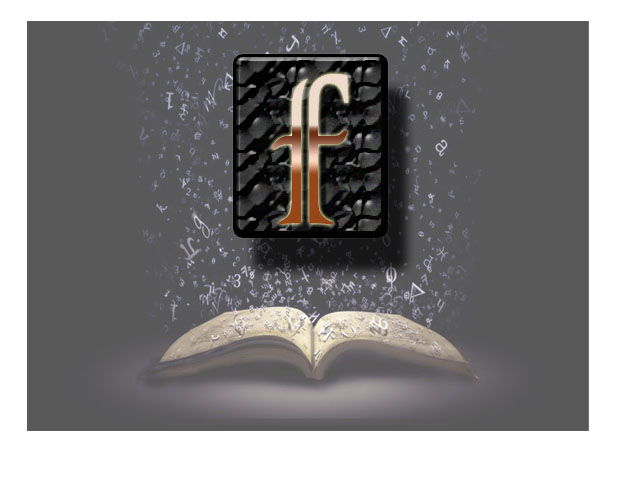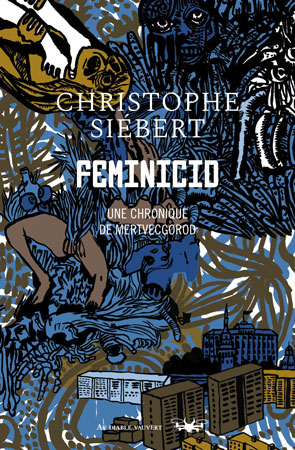Images de la Fin du monde et Féminicid, les deux premiers romans dans les chroniques de Mertvecgorod font choquer plus d’un·e d’entre vous… Et pourtant, les écrits de Christophe ne sont que le reflet d’une société elle-même violente. Mais trève de bavardage, je vous propose de découvrir notre échange…
Bonjour Christophe, avant toute chose, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Au moment où je réponds à cette question, j’ai 47 ans, vis à Clermont-Ferrand et la totalité de mon travail se situe dans le secteur d’activité de littérature : je suis organisateur de prix littéraire, chroniqueur, éditeur, performeur (comme ils disent), surtout auteur – je dis surtout parce que c’est cette dernière tâche que je considère comme mon véritable métier, que c’est à l’écriture de mes romans que je consacre le plus de temps et d’énergie, et que c’est d’eux que je tire la plus grande partie de mes revenus. De façon secondaire, je suis également alcoolique mondain, considérant qu’à Clermont-Ferrand les mondanités ressemblent davantage à une aimable cuite au troquet en bas de chez moi qu’à un pince-fesse au festival de Cannes.
Tu as écrit déjà 3 titres chez Au Diable Vauvert, Métaphysique de la viande et deux titres dans l’univers de Mertvecgorod Images de la Fin du monde et Féminicid . Pourtant, ce n’est pas dans la littérature de SF que tu as débuté.
Tout dépend si on prend on compte uniquement mes bouquins publiés ou la totalité de ce que j’ai écrit, et même si on parle de ma formation d’auteur ou de lecteur. J’ai commencé (comme lecteur) par lire aussi bien du polar, de l’horreur, de la SF et des trucs bizarres à la Georges Bataille, et comme auteur par plagier Lovecraft, qu’on peut, si on est bien luné, rattacher à la SF. Mais il s’est trouvé que mon premier bouquin publié (et il est sans doute le dixième ou douzième que j’ai écrit – je suis plutôt du genre laborieux) a paru en 2007 à La Musardine, éditeur spécialisé dans l’érotisme et la pornographie, ce qui m’a ensuite ouvert les portes de ce genre majeur, puisque j’ai signé au cours des deux années suivantes 6 romans de gare pour ce même éditeur (sous la direction d’Esparbec – dont j’avais lu les livres quand j’avais 14-15 ans, et dont je me suis rendu compte récemment, en les relisant pour rédiger une préface, à quel point ils m’avaient marqué et influencé), et que j’y suis maintenant directeur de collection.
Après ces six romans, mon écriture s’est diversifiée puisque j’ai écrit (et parfois publié, chez des éditeurs underground) de la poésie, de l’horreur, des nouvelles qu’on peut rattacher à la littérature blanche, de la SF, etc.
Quant aux Chroniques de Mertvecgorod, je ne sais pas si c’est de la SF ou pas, moi. J’aborde tous mes livres de la même manière : comme de la littérature réaliste contemporaine – que ce réalisme soit celui d’une ville qui n’existe pas, et que cette contemporanéité soit celle de 1970 ou de 2035 est un détail sans importance à mes yeux.
Par ailleurs, je suis bien content d’être au Diable vauvert, qui ne sépare justement pas son catalogue en plusieurs collections. Chez certains libraires, mes bouquins se trouvent au rayon imaginaire, chez d’autre en littérature générale ou même en polar. Et si mes deux derniers semblent relever de la SF, c’est surtout parce que le milieu de la SF les a repérés et a considéré qu’ils avaient leur place sur ce territoire-là – ce dont je me réjouis, vraiment, mais c’est la SF qui a décidé, pas moi.
Tu as partagé ton parcours sur les réseaux sociaux, partage qui a été repris par les éditions Au Diable Vauvert dans Fabrication d’un écrivain : il était important pour toi de parler de ton parcours ?
À vrai dire, non, ça n’était pas important pour moi. J’avais d’abord écrit cette série de posts sur Facebook pour exprimer ma joie d’avoir enfin trouvé une maison où je me sentais bien et où je pouvais vivre de mon travail, et ça s’est vite transformé, parce que je suis une Castafiore, en résumé de mon parcours depuis mes premiers textes, rédigés quand j’avais 12 ans, jusqu’au moment où, donc, j’ai signé avec le Diable. Il se trouve que Marion Mazauric, mon éditrice, est tombée sur ces posts et les a jugés intéressants au point d’en faire un petit livret, diffusé gratuitement en numérique et offerts (sur les salons, notamment) aux lecteurs qui le souhaitent. Au début j’ai trouvé ça très narcissique et embarrassant, et puis quelques lecteurs, écrivains débutants ou en galère, m’ont dit que la lecture de ce petit truc leur avait fait du bien et remonté le moral, ce qui m’a fait plaisir et évacué la question de la légitimité, à mes yeux en tout cas, de l’existence de ce texte.
Venons-en maintenant à la République indépendante de Mertvecgorod par cette question : d’où vient ce nom ?
Mertvecgorod signifie, en russe, « la cité des morts » ou « la cité des cadavres ». Quand, au douzième siècle, les vikings de la dynastie des Riourikides établissent une garnison sur le territoire qui deviendra la future mégapole, ils mettent au jour, en creusant des fondations, tout un tas de fosses, remplies de squelettes, vestiges d’une civilisation antique portée sur le sacrifice humain (pour ceux qui veulent en savoir plus, la fiche Wikipédia complète se trouve en annexe dans Images de la fin du monde et reproduite sur le site consacré aux Chroniques. Le nom de cette petite ville de garnison vient de là et n’évoluera pas au fil des siècles, tandis que la cité s’agrandira et passera de mains en mains, au gré des bouleversements historiques et politiques qui agiteront cette partie du monde.
Nous découvrons un pays coincé entre son passé ex-soviétique et son entrée dans la grande danse du capitalisme : as-tu un attrait particulier pour la période soviétique ou est-ce le grand écart du changement de politique qui t’intéressait ?
Avant de choisir cette région du globe pour y installer ma ville, je ne m’intéressais pas spécialement à l’histoire de l’URSS ou de la Russie pré et post-soviétique – en tout cas, pas davantage que tout un chacun. Ce que je voulais, en revanche, c’était bâtir un décor assez excitant et riche pour je puisse m’y installer et y raconter des histoires pendant dix, vingt, trente ans. Ce décor devait répondre à un certain nombre de caractéristiques : être une ville immense mais pas surpeuplée, que cette ville soit ancienne au point que plusieurs civilisations s’y soient succédées, qu’elle se situe dans une région du monde où ni le contexte historique et culturel, ni le climat, ne me soient totalement étrangers, afin de ne pas me surcharger en documentation. Le sud-ouest de la Russie s’est donc imposé par élimination et c’est seulement ensuite, en me documentant pour nourrir et fabriquer mon décor, que non seulement j’ai appris des tas de choses et que mon récit a commencé à prendre forme de façon plus concrète, mais aussi que je me suis passionné pour cette partie du monde, son histoire et sa culture – au point, d’ailleurs, de ne pratiquement plus écouter que de la musique (punk, post-punk, électronique, indus, noise, bizarro, etc.) de ce coin-là. (Pour les lecteurs les plus acharnés, j’ai un compte Instagram où je partage certaines de mes trouvailles)
Les deux récits sont hyper-violents, que ce soit physiquement, sexuellement et dénués de toute forme de morale : n’as-tu pas peur de faire fuir tout un lectorat ?
J’écris sur des sujets qui me préoccupent et ces sujets ne sont pas très marrants – mais ce sont ceux-là qui me préoccupent, je ne me vois pas raconter les problèmes de couple que traversent des individus financièrement à l’aise, je laisse ça à Alexandre Jardin et ses confrères.
Dans mon dernier roman, Feminicid, je parle bien sûr de féminicide, mais aussi de pédophilie, de trafic d’organes, de la façon dont le pouvoir est un poison qui corrompt les âmes, etc. Je crois que si la littérature devait servir à quelque chose, ce serait à ça : permettre à des lecteurs d’aller faire un tour dans les zones de l’expérience humaine auxquelles ils n’ont pas accès dans leur vie quotidienne, d’aller voir à la cave, de s’enfoncer dans le marécage.
Je ne sais pas si mes fictions sont dénuées de morale ou pas. Je sais en revanche que certaines situations affolent la boussole morale de mes personnages (et que l’éthique d’un journaliste qui se prend pour un héros n’est pas la même que celle d’un enfant des rues devenu oligarque), et que si j’ai bien réussi mon coup elles devraient aussi perturber celle de mes lecteurs.
Quant à la manière dont les lecteurs reçoivent mes livres, c’est effectivement une question qui me préoccupe. Dans mes premiers ouvrages, je n’en avais rien à foutre, je croyais que s’intéresser à ça entraînait forcément une sorte d’affadissement et de compromission. Mes livres d’alors (pour la plupart non publiés ou désormais introuvables) reflétaient cet état d’esprit.
À partir de Nuit noire (écrit en 2008 et réédité au Diable vauvert en 2019, en double-programme avec Paranoïa, sous le titre de Métaphysique de la viande), j’ai réfléchi autrement aux termes du problèmes : des auteurs tels que Bret Easton Ellis, Dennis Cooper ou Georges Bataille allaient bien plus loin que moi et pourtant leurs lecteurs étaient nombreux.
Ce qui fait qu’un lecteur reste à bord ou saute en marche, ça n’est pas le sujet, ni l’intrigue, ni les situations, ni les personnages : c’est la langue et uniquement la langue. Les voix, les rythmes, la composition, ce qu’on appelle de façon impropre et déplorable le style. J’essaie donc que tous ces éléments combinés procurent au lecteur une jouissance assez grande pour qu’il tourne les pages et aille au bout du parcours que je lui propose – parcours davantage de l’ordre du train-fantôme ou du rollercoaster que de la balade en barque, certes, et à ce titre : chacun ses goûts. On a le droit de préférer le canotage aux montagnes russes (et hallucinées).
À propos du lectorat : la marque, le label, compte. Je m’explique : Nuit noire est sans doute mon roman le plus extrême. J’y raconte la vie d’un tueur en série et le récit, rédigé à la première personne par le tueur lui-même, ne fait l’impasse ni sur les fantasmes dérangeants, ni sur les situations horribles. Ce livre, j’ai commencé à le publier par épisode sur des sites de black metal d’où je me faisais virer parce que les internautes trouvaient que j’allais trop loin. En 2019, ce même livre, édité au Diable vauvert sans en changer la moindre phrase, m’a valu de participer à Livre Paris à une table ronde animée par Michel Field, devant 300 personnes, et de gagner un prix littéraire, le prix Sade. Des lecteurs qui habituellement ne lisent pas ce genre de littérature l’ont découvert parce qu’il était publié chez un éditeur prestigieux, et certains d’entre eux l’ont aimé. Je suis convaincu que s’ils l’avaient vu sous forme de fanzine ils n’y auraient pas jeté un seul regard – et, s’ils l’avaient fait, ils auraient trouvé ce truc dégoûtant et illisible. Donc, une manière de me soucier de la réception de mes textes par les lecteurs a aussi été de vouloir signer chez un éditeur à l’excellente réputation.
Dans Images de fin du monde, nous découvrons différents portraits, certains d’entre eux revenant dans Feminicid. De même Feminicid s’appuie sur un élément en toile de fond du premier volume… Doit-on comprendre que tu vas développer chaque intrigue ?
Le cycle dans son ensemble comptera 8 ou 9 chroniques. La première, Images de la fin du monde, proposait une entrée en matière à travers une mosaïque de brefs récits interconnectés, soutenus par plusieurs fils conducteurs (l’attentat du 27 avril 2025, entre autres, et la danse de mort, dont tu parles plus bas). Feminicid développe des aspects précis du monde à travers un récit unique. Ce sera aussi le cas des deux ou trois suivants, qui révéleront de plus en plus complètement le tableau d’ensemble. Puis surviendra un événement important, majeur, qui rebattra toutes les cartes, et le cycle explorera alors les conséquences de cet événement, jusqu’à une forme de conclusion.
J’ai été marqué par « La Danse de Mort » et le combat « Fight Club » dans le premier : d’où sors-tu des idées aussi sombres ?
Je les sors du monde réel !
Pour « La Danse de mort », je me suis simplement demandé vers quelle forme de révolte pourraient se diriger des jeunes gens à la fois écœurés par les adultes, convaincus que toutes les stratégies existantes, y compris l’action directe, sont des impasses, et qui seraient éduqués politiquement, bien qu’en pleine déroute morale. Je ne serais pas surpris que des actes terroristes du genre de la danse de mort deviennent notre quotidien, d’ici quelques années ou décennies (si on survit au Covid, bien sûr). Non pas que je sois un prophète, aucun auteur ne l’est, mais, comme le disait Don DeLillo : chaque fois qu’un écrivain imagine un complot ou un coup tordu quelconque, on peut être sûr que quelque part dans le monde, des gens sont déjà en train de le mettre en œuvre.
« Fight Club » est une petite fable que j’ai pensée comme un hommage à Dostoïevski, dans laquelle je parle de combats clandestins qui présentent la particularité d’être livrés par des combattants télécommandés par des pilotes : ça ressemble à un jeu de baston de type Mortal Kombat, mais à la place d’avatars virtuels, ce sont de vrais types qu’on utilise, de préférence pauvres, prêts à tout pour un peu de pognon, et qui se foutent pour de bon sur la gueule – et ce sont les joueurs, ceux qui tiennent les manettes, les vedettes, évidemment. Cette idée m’est venue en lisant un article scientifique racontant qu’une équipe de chercheurs avait réussi à installer une puce dans le crâne d’un cafard, permettant de le contrôler à distance exactement comme un jouet télécommandé : d’où le nom de cette discipline.
Dans Feminicid maintenant, nous commençons à percevoir, où peut-être me trompe-je, la résurgence d’une forme de pouvoir ancestral ?
Je ne peux pas vraiment apporter de réponse tranchée à cette question. En tout cas, certains des protagonistes de cette histoire semblent croire dur comme fer que des forces cosmiques sont à l’œuvre dans l’Univers, voire le régissent de fond en comble, et qu’il est possible de maîtriser ces forces pour acquérir une forme de pouvoir – politique, par exemple. Quant à savoir s’il s’agit d’un tissu d’âneries ou une réalité objective, je laisse le lecteur se forger sa propre opinion. C’est aussi pour ça, d’ailleurs, que je tenais, dans Feminicid, à cette forme qui multiplie les instances narratives, les témoignages, les documents, etc. Pour instiller en permanence, dans l’esprit du lecteur, une forme de doute, ou en tout cas de méfiance, à l’égard de ce qui lui est présenté comme des faits irréfutables ou des conclusions définitives. D’après Todorov, la littérature fantastique naît de l’ambiguïté, de l’impossibilité de savoir si c’est vrai ou pas, et les rapports que mon livre entretient avec le surnaturel s’inscrivent dans cette veine-là.
Même si j’ai trouvé le récit très noir et très violent, on sent une volonté de quelques-uns de vouloir faire la lumière : c’est un espoir pour notre futur ?
C’est même un espoir pour notre présent ! J’ai une conviction, profondément ancrée, et confirmée par mon expérience personnelle : bien que nous vivions dans un monde globalement pourri, fabriqué et possédé par des individus globalement pourris, bien que ce monde soit en train de sombrer (et laissera place, s’il laisse place à quelque chose, à un enfer au moins aussi pourri que celui-là), il est possible, à titre individuel, et à travers quelques rapports humains rares et précieux, de frôler le bonheur ; il est possible de se construire un petit territoire paisible et agréable. J’essaie que mes fictions reflètent cette conviction et cette expérience personnelle, qui est mon maximum en termes d’optimisme, et qu’on pourrait aussi résumer ainsi : puisque tout est foutu, autant reprendre une bière, raconter des conneries et se rouler des pelles. Ou, comme le chantent les Legendary Pink Dots à longueur d’album : « sing while you may ».
J’ai du mal à percevoir la direction que vont prendre tes romans, et de quelle façon tu vas nous surprendre pour ton prochain titre : d’ailleurs Écrits de prison est indiqué pour 2023… Vraiment ? il faut attendre ?
Attendre, oui et non. Pour les plus impatients, des textes courts paraissent régulièrement en revue (on peut suivre mon actualité sur ma page Facebook), et il y a aussi le Fenzin, un webzine regroupant 22 auteurs, illustrateurs et musiciens qui ont accepté ma proposition de visiter cet univers et d’y raconter ou d’y montrer ce qui leur chante. On peut consulter ou télécharger gratuitement le Fenzin à cette adresse . Il y a enfin d’autres auteurs, débutants ou confirmés (je peux pour l’instant citer Ernest Thomas, Clément Milian et David Haybon) qui travaillent sur des romans se situant à Mertvecgorod. Leurs travaux sont à différents états d’avancement, mais je pense qu’on peut s’attendre à des annonces de parutions au cours des prochains mois.
Quant à moi, oui, le prochain volume est prévu pour 2023, et les suivants paraîtront en conservant ce rythme d’une chronique tous les 18 mois. Si vous ne voulez pas attendre, un seul moyen : faites en sorte que les bouquins soient des best-sellers !
D’ailleurs, combien de volumes sont prévus à date ?
Au Diable vauvert, 8 ou 9. Et si on prend en compte les envies des uns et des autres, et en considérant que tout le monde aille au bout de son délire, ce sera quelque chose comme une trentaine de volume, peut-être davantage, qui constitueront l’ensemble des Chroniques de Mertvecgorod d’ici une petite paire de décennies.
J’ai l’habitude de laisser le mot de la fin à l’invité, à toi de jouer.
Eh bien, puisque tu m’en laisse l’occasion, j’aimerais remercier le milieu de la SF, lecteurs, critiques, blogueurs, organisateurs de salon, confrères, tout ce petit monde, pour le chouette accueil qu’ils ont réservé à mes bouquins. J’espère que ça va continuer !