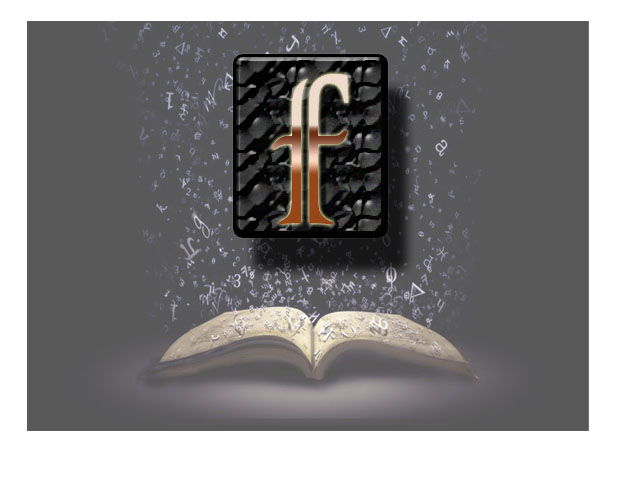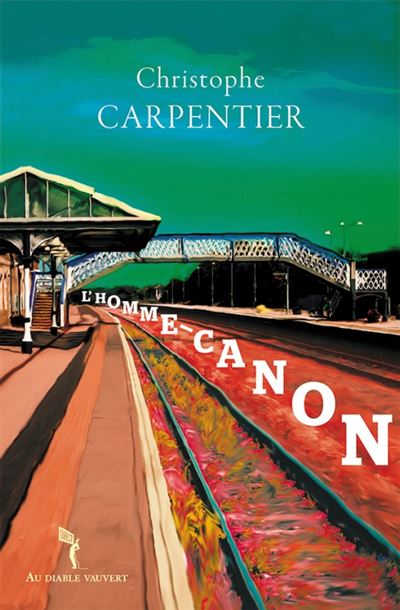Après nous avoir fait découvrir un monde post-apocalyptique avec Cela aussi sera réinventé, dans lequel le sédentarisme est vu comme une des causes de la chute du monde tel que nous le connaissons, Christophe Carpentier nous propose avec L’Homme-Canon de questionner notre société de l’immédiateté et la place de la culture. Et dans les deux cas, c’est Au Diable Vauvert.
Le format du récit colle d’ailleurs tout à fait au propos. Nous vous proposons ici de découvrir l’écrivain derrière le texte !
© – Crédit Photo : Ph. Matsas / Au Diable Vauvert
Bonjour Christophe. Avant de parler de tes deux parutions chez Au Diable Vauvert, j’ai envie de te demander à quel moment tu as décidé d’être écrivain ?
J’ai débuté l’écriture de mon premier roman à l’âge de 18 ans. A cette époque, j’étais un peu perdu. J’avais choisi une orientation universitaire – le Droit – dans laquelle je m’enlisais. Je peinais à trouver ma place dans un récit qui fût ma propre histoire, et non celle que m’imposait ma famille. En écrivant, j’ai pu utiliser des personnages de fiction – malléables et conciliants à souhait – et ainsi décortiquer les mécanismes romanesques qui entrent en action dans une histoire. J’ai adoré créer des rencontres, édifier des réussites et des échecs, saupoudrer des enseignements sur telle ou telle situation, mais surtout structurer une narration. Je ne sais quand exactement j’ai eu conscience que cet exercice-là – complexe et abstrait – m’aidait à mieux comprendre et à mieux accepter ma propre existence, mais une fois ce cap passé je n’ai plus pu me passer d’écrire, et c’est à ce moment-là que je suis devenu écrivain. Car c’est quand on est devenu addict à l’écriture, c’est quand on se trouve dans l’obligation viscérale d’écrire chaque jour de votre vie, que l’on est réellement un écrivain, et non quand on est publié.
Les premières années, j’ai écrit des textes sans avoir la prétention de les envoyer à une maison d’édition. Je savais que le résultat n’était pas bon, et que la phase d’apprentissage allait être longue. Plus tard je les ai envoyés. J’ai essuyé pas mal de refus, mais le besoin d’écrire n’en a jamais été affecté, au contraire. C’est dans cette double phase d’apprentissage et de refus que se joue la sélection naturelle entre qui est déjà écrivain et qui ne le sera jamais
Avant de rejoindre les rangs des auteurs Du Diable, tu as publié chez Denoël ou encore chez P.O.L…. Y-a-t-il une différence en tant qu’auteur à être chez l’un ou chez l’autre ?
Ce qui différencie surtout Denoël de chez P.O.L, c’est que chez P.O.L j’étais en contact direct avec le fondateur de la maison d’édition, à savoir Paul Otchakovsky-Laurens. Tandis que chez Denoël, mon interlocuteur était Olivier Rubinstein, un directeur général nommé par le conseil d’administration qui succédait à un précédent directeur général. Cette différence de statut est énorme. Un directeur général pense au chiffre d’affaires, un fondateur va avoir une vision plus paternelle et intime de votre travail qu’il va replacer dans l’arbre généalogique de ses auteurs. Car pour un fondateur, les auteurs font tous partie de la même famille, SA famille qu’il a pris soin de réunir, année après année, au cœur du vaste brouillard poétique de sa sensibilité d’éditeur. C’est pour connaître cette même estime paternelle, et ce même lien filial – tous deux porteurs d’exigence et de confiance réciproques – qu’au moment de quitter P.O.L, après la mort accidentelle de Paul le 2 janvier 2018, j’ai envoyé un manuscrit à Marion Mazauric, la fondatrice des éditions Au diable vauvert. Par chance elle m’a laissé grimper sur son arbre généalogique, et depuis je fais tout mon possible pour ne pas en redescendre.
Deux titres sont parus Au Diable Vauvert avec deux thématiques qui sont malgré tout pour moi liées. Alors que Cela aussi sera réinventé se concentre sur les conséquences de l’inaction climatique pendant que L’Homme-Canon s’intéresse à la culture de l’immédiateté et les conséquences du “Quoi qu’il en coûte”… Doit-on déduire que la crainte de l’avenir te hante ?
Il faudrait être bien naïf, cher Allan, ou bien vivre avec la tête dans le sable pour penser que l’avenir de l’humanité va être rose. Lorsque je m’attaque aux bouleversements sociétaux et psychologiques que le Dérèglement climatique va induire (Cela aussi sera réinventé) ou à la constitution sournoise d’une Société de la manipulation par l’exemplarité citoyenne (L’homme-canon), je le fais pour tirer la sonnette d’alarme qui résonne alors à ma petite échelle d’écrivain science-fictionnel. Les fondations sociologiques et anticipatrices de mes récits me permettent en effet de mettre en évidence des dérives qui, parce qu’elles sont en train de se former, passent encore inaperçues aux yeux du plus grand nombre. L’auteur a l’avantage d’avoir le temps de faire silence et réflexion. De ces deux luxes que beaucoup de nos concitoyens pris dans le tourbillon de leur vie n’ont pas, l’auteur doit faire bon usage en livrant des histoires distrayantes, parfois drôles, mais qui toutes procurent sens et utilité à qui les lit.
Mais si crainte de l’avenir il y a – dans ses implications morales et comportementales – je ne remets jamais en question la certitude que cet avenir existera, avec toutes les fulgurances d’excellence propres à un exercice à la fois lumineux et sombre de l’existence.
On voit aussi que dans Cela aussi sera réinventé, la philosophie de vie est énormément mise en avant, notamment au travers de la façon de vivre des Nomades Décontextualisés. La philosophie tient-elle une place importante dans ta vie ?
J’aime lire des textes philosophiques autant que des romans (certains d’ailleurs sont les deux, comme la Nausée de Sartre ou Bartleby de Melville). L’invention d’un concept par un philosophe (la Monade chez Leibniz ou le Noumène chez Platon et Kant) est une fascinante création artistique de l’esprit, car il est à chaque fois une clef de décodage du réel que le philosophe offre à ses lecteurs. Je pense donc qu’il n’y a pas acte artistique plus généreux que la fabrication d’un concept par un philosophe.
Pour autant je n’admire pas un philosophe en particulier. Je ne suis l’adepte d’aucune école philosophique. Je circule dans plusieurs philosophies différentes, souvent simultanément, glanant de-ci de-là des éclaircissements ou des problématiques que je fourre dans mon shaker mental avec l’opportunisme de celui qui cherche avant tout à mieux supporter le lot de contraintes, de déceptions mais aussi de bonheurs inouïs que représente le fait d’exister à la fois par soi-même et par les autres.
La philosophie – et plus particulièrement la métaphysique – m’aide ainsi à réduire la sensation d’éparpillement de mon être qui me saisit dès le réveil, lorsque je pense aux gens que j’aime et au fait que je ne contrôle quasiment rien de tout ce qui se passe autour de moi. Pour conclure sur ce point, je voudrais dire que nous vivons dans des sociétés aux règles et aux codes de plus en plus complexes. La simple nécessité de s’y adapter – et là je ne parle même pas de s’y épanouir – implique de notre part à tous des trésors de raisonnements et d’analyses qui font de nous – qu’on le veuille ou non – des êtres intellectuels et philosophiques à part entière.
Venons-en à L’Homme-Canon paru en début d’année. Ce texte est très particulier et nous plonge dans une société post-Covid, où l’heure de faire les comptes est arrivée… Comment le présenterais-tu ?
L’Homme-canon est une fable dystopique, teintée d’un humour grinçant, et comme toutes les fables, celle-ci possède une morale. Mais comme la plupart des fables de la Fontaine, la morale de l’Homme-canon n’est pas explicite. C’est au lecteur de la formuler à partir de son propre vécu autobiographique, de sa propre grille de valeurs. Mon écriture n’est pas manichéenne. Mes personnages sont tous ambivalents, tous comme les modèles sociétaux dans lesquels ils évoluent. Selon moi un auteur doit avant tout restituer la complexité des contextes et des psychologies qui en découlent. Rien n’est jamais que ceci ou que cela mais en même temps ceci et cela. Un cadre narratif capable de restituer cet oscillement contradictoire permanent de l’existence permet au lecteur de prendre position, de façon pacifique et posée, sur un sujet aussi vaste que Qu’est-ce que résister à notre époque ? Et de manifester ses convictions ou de revendiquer des droits nouveaux sans quitter le confort de sa chambre ou de son salon, avant, qui sait, d’avoir l’élan et le courage de le faire dans la rue.
Notre Homme-Canon va pousser les habitants et habitantes du village à se questionner, chose qui semble être devenue totalement obsolète dans une France devenue focus sur l’immédiateté… Crains-tu que la culture BFM en viennent à remettre l’existence même de toute forme de réflexion ?
Allan, si tu entends par Culture BFM la pratique d’un gavage informatif, immédiat, continuel et sans prise de recul analytique, alors en effet on peut considérer qu’on nage déjà en plein dedans.
Mais il n’y a pas que du mauvais, loin de là, dans le besoin empathique de savoir ce qui se passe autour de soi. Le problème vient de ce qu’il se passe tellement de choses qu’on ne peut toutes les englober qu’en procédant à leur survol. Je préfère cette quête effrénée d’informations que l’indifférence ou le dédain misanthropiques. Le problème, c’est qu’à force de survoler à très haute altitude la méta-information produite H24 dans le monde, on finit par ne plus rien différencier, par tout uniformiser dans une gigantesque bouillie brouillonne où l’humanité apparaît sous la forme d’un golem errant à la surface du monde. Or cette vision-là ne peut provoquer en nous qu’abattement et résignation, à l’heure au contraire où la mobilisation de tous devrait être de rigueur.
On est devenus accros à l’accumulation de petites données factuelles bonnes à être restituées au cours d’une conversation. On aime s’approprier – moi le premier – le dernier scoop et en devenir le dépositaire le temps de l’annoncer autour de soi. Cette pratique-là, fort addictive, relève du narcissisme médiatique, et ma foi, elle est bien compréhensible. Elle vaut mieux, de toute façon, que cette haine médiatique, lâche et clivante, véhiculée par la Culture CNews, orchestrée par l’industriel Vincent Bolloré qui se targue d’être un catholique pratiquant, alors qu’il bafoue sans vergogne – d’après ce que j’en ai lu au catéchisme – les enseignements de son prophète Jésus.
Tu met beaucoup en avant ce côté “Héros du quotidien” et je n’y avais pas pris plus attention que cela : vois-tu un danger à vouloir mettre constamment des métiers en avant ?
La présentation des métiers n’est pas un danger en soi. Ce qui l’est, c’est l’orientation partisane qui est en action derrière la valorisation de certains métiers plus que d’autres. La multiplication de reportages sur les policiers, les gendarmes, les pompiers ou les urgentistes provoque chez le téléspectateurs un double besoin : d’abord celui de consommer des faits avérés dont l’authenticité ne peut être remise en question puisqu’ils ont été filmés en DIRECT par des caméras ; ensuite le besoin de voir des héros du quotidien en exercice, voire d’assister à l’héroïsation en direct de certains citoyens plus glorieux et moraux que la moyenne.
Je ne sais pas si l’audience de ces reportages-vérité est bonne. Mais ce que je vois, c’est qu’ils se multiplient d’année en année, avec le double écueil qu’ils accréditent l’idée que seul ce qui est filmé est vrai (niant ainsi la part de scénarisation orientée du montage) et qu’ils intègrent à leur narration des jugements de valeur à forte teneur pédagogique. Montrer des policiers ou des gendarmes en action permet de présenter les comportements délinquants auxquels ils sont confrontés et de les dénoncer sans s’attarder sur leur justification sociologique. On va voir un toxicomane voler pour se payer sa dose, ou un alcoolique ivre au volant, et aussitôt, même avec empathie, on va nous asséner un laïus moralisateur reprochant le manque de civisme ou de responsabilité de ces personnes-là. Ainsi, non seulement ce genre d’émissions d’héroïsation de certaines professions formatent le spectateur en l’enjouant à respecter la loi, mais il laisse penser qu’avec un peu d’effort de chacun et un peu moins d’individualisme on pourrait vivre dans un monde débarrassé de toute délinquance ou criminalité.
Or non, les comportements délinquants ou criminels ne relèvent pas de la facilité. On ne peut pas les éradiquer grâce à des laïus bon-enfant, et encore moins grâce à des jugements à l’emporte-pièce. Ils sont profondément ancrés dans l’ADN humain, et nécessitent de la part des réalisateurs et des spectateurs une réflexion citoyenne de fond.
Il y a tant de questions à poser autour de L’Homme-Canon et de la société qu’il reflète, je limiterai du coup à une seule : penses-tu que le genre de la Science-Fiction a plus qu’un autre cette faculté à mobiliser et questionner plus que d’autres formats sur notre avenir et ses possibles dérives ?
La crise du Covid 19, ses répliques passées et sans doute à venir, ainsi que la guerre en Ukraine, nous ont tous transformés, quel que soit notre âge et notre socle culturel, en adeptes inconditionnels d’une pratique à laquelle nul à présent ne peut échapper : l’anticipation analytique et critique des lendemains qui déchantent.
De quoi notre avenir immédiat sera fait ? Cette question nous nous la posons chaque matin en nous réveillant, tout autant que nous nous demandons si Kiev va être conquise, ou si Poutine va déclencher une guerre nucléaire.
Ainsi depuis trois ans, nous sommes tous devenus des écrivains de science-fiction. Nous mettons tous bout à bout des éléments du vaste puzzle informatif qui constitue notre présent médiatique en nous demandant avec angoisse de quoi ce-dit présent sera fait dans deux jours, dans une semaine ou dans un an.
Dans un tel contexte, la communauté des êtres science-fictionnels s’est démultipliée à l’infini des sept milliards d’humains qui peuplent la terre. Il n’y a plus d’un côté les lecteurs et les auteurs de SF, et les autres. Il n’y a plus qu’un présent lui-même devenu science-fictionnel, car annonciateur d’un avenir à ce point incertain et dérivant qu’on ne peut s’empêcher d’en écrire notre propre version.
Parlons aussi de la forme ! L’Homme-Canon est une pièce de théâtre et pourtant, cela n’est pas dit. Y-a-t-il une raison particulière ?
L’Homme-canon a la forme d’une pièce de théâtre, c’est indéniable. Mais si avec Marion Mazauric et Nathalie Paino il a été décidé de ne pas mentionner « Théâtre » sur la couverture, c’est parce que l’Homme-canon est du théâtre mais également autre chose. Ainsi ce texte n’a pas été écrit dans le but d’être joué sur une scène. Si les dialogues sont omniprésents, la trame romanesque ne s’est pas trouvée limitée par la configuration narrative habituelle d’une pièce de théâtre. Que ce soit dans les pièces de Racine, de Tchekhov ou de Vinaver, les personnages sont comme aimantés par une problématique commune qui elle-même provoque un rétrécissement mais aussi une extrême cohérence (voire une cohérence idéale et outrancière) du champ romanesque souvent réduit à un seul problème d’héritage, de spoliation ou d’amour coupable. Dans l’Homme-canon, si cohérence de la problématique il y a, j’ai veillé à ce que les champs romanesques ne soient pas contractés, mais qu’ils puissent au contraire jouir d’une totale latitude d’expansion. C’est en cela, je pense qu’il s’agit davantage d’un roman théâtralisé ou d’une pièce de théâtre romancée, que d’une pièce de théâtre pure et dure.
Dans mon précédent écrit intitulé « Cela aussi sera réinventé », je faisais la part belle aux dialogues, tout en multipliant les passages analytiques et descriptifs qui constituent l’ADN narratif propre au roman. J’ai continué sur cette lancée, après m’être aperçu que les personnages gagnaient en individualité et en force lorsqu’ils s’expriment en leur nom propre de bout en bout du récit. En quelque sorte, à n’être qu’eux-mêmes et rien que cela – de manière frontale, nue et assumée, sans pouvoir se cacher dans la forêt de texte qui les entoure habituellement dans un roman – ces personnages cessaient d’être ma seule création, ils gagnaient en autonomie à mesure que je me trouvais moi-même comme dépossédé de mon droit de vie ou de mort sur eux. Or, c’est justement le plaisir de cette dépossession-là qui m’a poussé à écrire d’autres pièces romancées.
J’ai cru comprendre lors de ta visite à BienVenus sur Mars que 2 autres histoires sur le même format sont en prévision… Peux-tu nous en dire plus ?
Deux autres pièces romancées ont d’ores et déjà été écrites en effet. L’une s’appelle Carnum, l’autre Shelter. Avec l’Homme-canon elles formeront un ensemble que j’ai appelé le Théâtre du Plausible, dans le sens où elles ont pour finalité d’adapter à la forme théâtrale les codes inventifs de la Littérature de l’Imaginaire. Ainsi l’Homme-canon, pour ne citer que ce texte a-t-il repris sous forme exclusivement dialoguée les codes de la dystopie. J’ai en effet été surpris de voir que la forme théâtrale était restée jusqu’à présent le monopole exclusif de la Littérature blanche. J’ai voulu remédier à cette injustice en proposant au lecteur un théâtre du Plausible dans lequel l’esthétisme et le plaisir qui en découlerait viendraient – comme dans la SF traditionnelle – de toute la dynamique de persuasion mise en branle par l’auteur pour convaincre son lecteur que ce qu’il lit, aussi débridé et improbable soit-il, est plausible, c’est-à-dire suffisamment structuré et cohérencé pour faire office de réalité. Je ne peux dévoiler le contenu des deux prochaines « pièces » mais leur caractère extraordinaire est systématiquement tempéré par toute une série de détails méticuleux qui assurent la cohérence du Fantastique et rendent ce dernier totalement crédible, voire préalablement familier. Cette tâche a été d’autant plus ardue que la forme dialoguée sert de caisse de résonance à ce qui est formulé, et risque donc d’amplifier les incohérences et le manque de crédibilité d’un personnage qui, comme je l’ai précédemment dit, est seul dans son dialogue et ne peut se cacher dans la forêt narrative qui l’entoure habituellement dans un roman.
Le mot de la fin t’appartient !
Ne cessons jamais d’écrire ni de lire de la fiction, car cette dernière est source d’un apprentissage et d’une initiation qui lui sont propres, et qui diffèrent grandement de ce que la réalité peut nous apporter.
Je parle bien entendu de la vraie fiction, celle qui s’assume comme telle, et non celle qui, via des fake-news propagandistes, ambitionne de se faire passer pour la réalité.
L’artiste fictionnel est confronté à un impératif de plausibilité que ne connaît pas le documentaliste ou le biographe qui restituent fidèlement le réel. Or, c’est dans la tension artistique générée par cette confrontation-là que se situe l’esthétisme propre à la fiction.
Ni le Hamlet de Shakespeare, ni le Meursault de Camus, ni le Rick Deckard de K. Dick, et encore moins le Redrick Shouhart des frères Strougatski n’ont existé, mais leurs créateurs les ont rendus à ce point plausibles qu’ils se sont invités de force dans notre réalité référentielle. Or c’est justement dans ce passage en force que se situe leur caractère indispensable et quasi métaphysique.